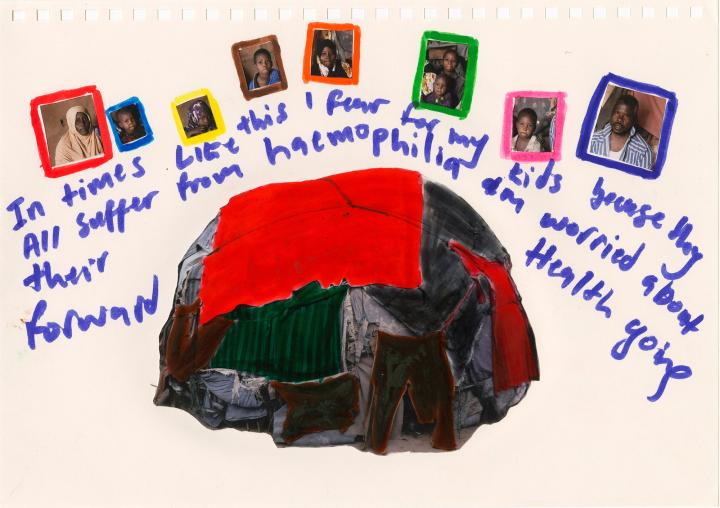Zones de conflit, la violence du réel

Beyrouth, Liban, 1977. Un homme amputé de la jambe gauche, vraisemblablement à cause de la guerre civile, observe un bâtiment détruit par un bombardement.
© A. Abbas / Magnum Photos« On soignait sous le feu des tireurs d’élite. » Ainsi raconte un volontaire MSF tout juste de retour du Liban dans les colonnes du journal Tonus, le 14 juin 1976. Dans ce pays, la guerre civile fait rage depuis le printemps 1975. Au Liban, MSF intervient pour la première fois au cœur d’un conflit et non plus à la périphérie. Pendant quasiment une décennie de violence, plus d’une dizaine de photographes de l’agence Magnum sont allés couvrir la réalité des Libanais piégés entre les lignes de front mouvantes et quelques fois abstraites. Dans ce contexte extrême, comme dans quantité de conflits contemporains, les photographes se donnent la mission d’être témoins, tout comme les humanitaires en complément de leur mission d’aide. Chacun à leur manière, ils racontent, depuis 50 ans, la complexité, la détresse mais aussi la dignité des populations qui survivent à l’absurde violence.
Au plus fort des combats, s'exposer
Dès la fin d’année 1975, à la demande du Croissant Rouge palestinien, MSF intervient à Beyrouth dans le quartier assiégé de Nabaa-Borj Hammond. Cette enclave chiite isolée en territoire chrétien abrite une centaine de milliers de personnes coupées du monde. La petite équipe, composée d’un chirurgien, d’un anesthésiste et de deux infirmières, travaille nuit et jour pour prendre en charge les blessés qui ne cessent d’affluer. Les humanitaires vivent dans les mêmes conditions que les Beyrouthins. Sans électricité, sans radio ni aucun autre moyen de communiquer, les équipes se relaieront dans la capitale jusqu’en juillet 1976, au plus fort des combats, lorsque l’hôpital doit fermer.
Par leur action, les humanitaires choisissent de subir la violence de l’intérieur au même titre que les populations, pour être au plus près de la réalité des besoins. Etre aux côtés des populations civiles signifie être auprès des plus vulnérables, qui sont aussi les moins visibles. Le rôle des humanitaires ne prend son sens que si cet objectif est atteint.

Beyrouth, Liban, 1983. Des enfants jouent dans les véhicules accidentés près du camp de Sabra et Chantila.
© Chris Steele-Perkins / Magnum PhotosDe même, pour les photojournalistes, documenter la guerre n’est pas seulement d’observer une tactique militaire, des explosions, mais surtout de suivre le point de vue des civils, être avec eux. C’est aussi le choix de Raymond Depardon, qui, au cours du mois qu’il passe à Beyrouth à l’été 1978, tente de saisir toutes les facettes de cette réalité et surtout les conséquences du conflit et tout ce qui se passe à la marge.
Abonnez-vous à la newsletter MSF


« Les musulmans, les chrétiens, la ville, les plages : Beyrouth était une terre de contrastes à cette époque », écrit Raymond Depardon. Mais la liberté de mouvement et d’action est toute relative au cœur d’une guerre civile. « J’ai appris à comprendre, à marcher, à circuler, à cacher mes laissez-passer dans mes chaussures, à ne pas me tromper – deux laissez-passer du côté chrétien et deux du côté musulman, à ne surtout pas confondre. »
Même récit côté MSF : « Notre véhicule ne portait aucune marque distinctive : utile chez les uns, elle nous aurait fait courir de grand risque chez les autres, raconte une infirmière MSF dans le journal interne MSF de 1986. Musulmans et chrétiens se sont succédés sur le siège du chauffeur pour nous permettre de traverser les différentes zones de Beyrouth et parvenir à notre hôpital ouvert dans la zone de combats. »
Puisque chaque guerre implique des enjeux politiques, les parties au conflit cherchent à prendre l’avantage par tous les moyens. Les humanitaires comme les photographes doivent donc négocier en permanence pour sécuriser leur espace de travail. Ainsi, en 1978, grâce au CICR, un cessez-le-feu de 3h est négocié pour le passage d’un véhicule amenant les volontaires MSF dans la ville chrétienne de Zahlé alors assiégée. Ils y restent jusqu’au bombardement de la ville en 1981. Le scénario sera le même à Deir el-Qamar en 1983. L’année suivante, MSF finit par se retirer car la sécurité des volontaires n'est plus assurée.
Si être au plus près des affrontements est essentiel, le danger reste omniprésent et les multiples contraintes obligent humanitaires et photographes à évoluer dans un environnement sans cesse changeant.
Accéder à la zone et préserver la mission
« Il peut toujours exister un moment précis où la frontière entre la précaution et le risque est franchie. La guerre est là, toute proche. Ses sursauts sont totalement imprévisibles, sa logique, un mystère auquel seuls les rares initiés ont accès. Pour l’équipe propulsée en quelques heures aux limites du brasier, voire en son sein, la première urgence est de s’adapter. Il arrive parfois que cette nécessité se fasse dans le déchainement subi des armes. » Ces mots sont ceux d’Alain Dubos, médecin, à propos de la mission MSF au Tchad en 1980.


Dès 1979, des groupes armés se disputent le contrôle de N’Djamena. Les populations fuient vers le Cameroun voisin où travaille une équipe MSF. En avril 1980, les médecins sont aussi dans la capitale tchadienne, soignant les blessés dans deux hôpitaux. Vu la violence du conflit, ce sont avant tout des soins de première urgence qui sont dispensés, notamment chirurgicaux. Pour préserver leur neutralité, les humanitaires viennent en aide aux deux camps, et ce, sur l’ensemble du territoire. Mais des rumeurs courent que les volontaires aident à faire passer des armes aux rebelles. Le soutien de la Libye à l’une des parties au conflit amène un sursaut de violence et une insécurité grandissante. En janvier 1984, deux volontaires MSF sont enlevés et retenus en otage pendant deux mois.
En Afghanistan, les photographes et les humanitaires sont les seuls témoins de la violence qui ravage le pays. Dès 1978, le photographe Raymond Depardon documente la situation et les conditions de vie au Nouristan, une province limitrophe du Pakistan qui s’est soulevée contre Kaboul. Claude Malhuret, alors président MSF, décide d’organiser une mission exploratoire à la suite de ce reportage paru dans Paris Match en avril 1979.




Juliette Fournot, cheffe de mission MSF de 1982 à 1989, a grandi en Afghanistan. « Je connais très bien ce pays, je parle leur langue. Ils me considèrent plutôt comme une sœur. Je pense que j’ai un devoir moral de faire ce qui est en mon pouvoir pour leur apporter cette aide médicale qui est beaucoup plus que simplement une aide médicale. Ils sont tellement abandonnés dans cette guerre interminable. »

Province du Logar, Afghanistan, 1984
© Steve McCurry / Magnum PhotosDans le nord du pays, la mission clandestine MSF se met en place à partir de 1980. Ce sont quatre tonnes de matériel médical qui est acheminé à dos de mulets et chevaux à travers les montagnes afghanes pendant 35 jours de marche. Les petits hôpitaux MSF soignent surtout les femmes et les enfants qui sont les principales victimes du conflit. « J’ai vu la guerre et ses conséquences, les gamins mutilés par les mines, leurs jambes infectées, nécrosées faute de soins, raconte encore Juliette Fournot. Je me suis dit, je reste. » De toutes les vallées, les familles affluent sans discontinuer, et ce sont près de 3 000 patients qui sont pris en charge chaque mois.
Les médecins sont les seuls à connaître la réalité des Afghans dans ces provinces reculées. MSF décide de prendre la parole et alerter l’opinion publique sur la situation. Dans une tribune du journal Le Monde du 25 septembre 1984, Claude Malhuret appelle à la responsabilité de chacun pour mettre fin à ce massacre. « En dénonçant ce qui se déroulait là-bas, nous "soignions" davantage de gens qu’en portant assistance à quelques Afghans que nous pouvions atteindre. »
Malgré la mobilisation internationale, les structures MSF sont régulièrement bombardées par l’armée soviétique. La situation se dégrade toujours plus au fil des ans, et l’insécurité oblige à suspendre les missions. La neutralité des humanitaires ne suffit plus : les rivalités entre groupes armés moudjahidines entraînent attaques, vols et prises d’otages. En avril 1990, l’assassinat de Frédéric Galland, logisticien MSF en mission dans l’hôpital de Yaftal, décide les humanitaires à se retirer du pays.

Kaboul, Afghanistan, 1995
© Steve McCurry / Magnum PhotosAutre contexte, autre temps, mais même déchainement de violence et même difficulté à remplir la mission humanitaire : en 2003 au Darfour. Ce conflit opposant les groupes rebelles et les milices janjawid armées par le gouvernement de Khartoum, a occasionné plus de 300 000 morts et des milliers de déplacés. Elsafi Mahadi Bushara, Darfouri d’origine et responsable logistique MSF au Soudan en 2020, se souvient de la vie avant l’explosion de violence dans sa région. « Avant le conflit, les tribus vivaient en paix, personne ne se déplaçait avec une arme. Aucun endroit n’était dangereux. Tu pouvais voyager sans un sou dans ta poche, partout tu étais accueilli chez les uns et les autres pour partager un repas. En 2003, cette division politique entre arabes et non-arabes a mis à sang le Darfour. " Prenez ce que vous voulez" était le mot d’ordre, "Prenez les terres, les propriétés et tuez ceux qui restent." »
Le photographe Paolo Pellegrin était au Darfour Sud pour témoigner de la détresse des populations déplacées par les vagues de violence. Elles vivent dans des conditions de vie très précaires et les enfants sont plus affectés.

Darfour Sud, Soudan, 2004. Jeune fille dans un camp de déplacés à Zelingei pendant un orage.
© Paolo Pellegrin / Magnum Photos

Les organisations humanitaires étaient présentes mais contraintes par les autorités de n’intervenir que dans les camps de déplacés avant de se faire expulser pour la plupart, accusées de soutenir les ennemis. « Comme les ONG travaillaient dans les zones rebelles, j’ai été arrêté et accusé d’être receleur pour MSF, poursuit Elsafi Mahadi Bushara. Les autorités n’ont pas trouvé de preuve et j’ai été relâché. MSF a ensuite été expulsée du pays. Donc en deux heures, on a brûlé toutes les archives pour que les autorités ne puissent pas inquiéter le personnel local ou les patients. Pour cela, j’ai loué une boulangerie qui avait un grand four à bois. »
La stratégie de « diplomatie silencieuse » qui consistait à alerter la communauté internationale dont le Nations unies sur les violences et les entraves au déploiement de l’aide, via des discussions bilatérales, n’aura pas abouti. Aujourd’hui, les cicatrices restent très visibles au Darfour, les flambées de violence n’ont pas cessé et des millions de déplacés sont toujours dans les camps, empêchés de rentrer chez eux.
Si les humanitaires et les photographes n’ont pas les moyens d’arrêter une guerre, ils travaillent sans relâche pour que l’impuissance ne soit pas la seule réponse
Agir et faire réagir
Tenter de sauver les blessés n’est peut-être pas assez. « Pour une fois, les MSF rompent le silence qui entoure leur mission. L’un d’eux a vu la folie des hommes se déchainer dans un Liban déchiré et veut en porter témoignage. » (Tonus, 14 juin 1976). C’est la première fois que la jeune organisation saisit l’importance de raconter, d’informer en dehors des discours des parties au conflit. En complément des récits des volontaires MSF, les photographes ont leur rôle à jouer. Car sans photographie, on pourrait croire qu’il n’y a pas de victime : la photographie met en présence des individus affectés, abolit la distance qui sépare la zone de guerre de l’observateur. La photographie introduit la médiation du regard entre la victime et l’observateur. Cet intermédiaire est le photographe qui cadre, saisit la réalité qu’il comprend.

Alep, Syrie, 2012. Une famille regarde la ville depuis son balcon. Pendant cette période du conflit, Alep a fait l'objet de combats très intenses.
© Emin Özmen / Magnum Photos« J'ai perdu la foi en beaucoup de choses, mais je continue à penser que documenter les conflits est essentiel pour l'histoire, pour la mémoire collective. Il est essentiel que nous n'oublions pas ce qui s'est passé. En 2012, un an après le début du conflit, les combats étaient aux portes de la Turquie. Alep (qui se trouve à 60 km de la frontière turque) a subi d'intenses bombardements aériens en juin. Cette tragédie se déroulait aux portes de mon pays, à seulement une heure de route ; je me sentais vraiment concernée et bouleversée par cette situation. J'y pensais tout le temps. Compte tenu de la nature de mon travail - photographe - et sachant qu'une guerre éclatait si près de chez moi, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai donc décidé de traverser la frontière pour témoigner et documenter ce qui se passait. »
Mais cette réalité s’appréhende difficilement, le travail de recoupe entre les témoignages est donc essentiel et prendre le temps est la seule option. Car dans un environnement si changeant, l’accès à l’information transparente et claire est impossible

Hama, Syrie, 2011. Des manifestants syriens anti-régime manifestent dans le centre de Hama lors d'un rassemblement matinal.
© Moises Saman / Magnum Photos« Au début des révolutions du printemps arabe, le rythme était trop effréné et il fallait couvrir l’actualité, je n’avais pas le temps de prendre du recul, m’interroger, explique le photographe Moises Saman, en Syrie en 2011. Cependant, avec le temps, il est devenu évident pour moi qu'au niveau visuel, les faits seuls ne permettaient pas de saisir la complexité et les implications de cette transformation historique. Au cours de mes cinq années de présence dans la région, il m'est devenu impossible de ne pas remettre en question les récits simples du bien contre le mal, après avoir vu de mes propres yeux avec quelle facilité les rôles de victime et d'auteur peuvent changer. C'est précisément dans ce paysage changeant que j'ai orienté mon focus, et que j'ai pu me questionner sur mon rôle et me mettre face à mes doutes. »

Alep, Syrie, 2012. Combattants de l’armée syrienne libre sur la ligne de front d'Al Arkub.
© Jerome Sessini / Magnum PhotosLe photographe Jérôme Sessini était aussi en Syrie, à Alep, en 2012, au milieu des affrontements post-printemps arabe. « J’avais mon avis sur la situation en Syrie, quelques idées, des a priori. Mais la première chose qui m’a le plus frappé, c’est le nombre de civils qui sont tués. On entend souvent : "tant de combattants ont été tués, tant de soldats, tant de militaires". Mais ce que j’ai constaté à Alep, ce sont beaucoup, beaucoup de civils qui sont tués. »

Marea, province d'Alep, Syrie, 2012. Fatma Al-Krama est entourée de membres de sa famille alors qu'elle est assise à côté du corps de son fils décédé, Habib Al-Krama, 25 ans, torturé et tué par les milices pro-Assad dans la ville d'Alep. Le corps d'Habib retrouvé dans une rue, a été ramené dans son village pour y être enterré.
© Moises Saman / Magnum PhotosDès 2011, en plus de son intervention directe auprès des populations, notamment dans les camps de déplacés, MSF soutient clandestinement de nombreuses structures de santé dans le pays par le biais d'autres acteurs sur place.
En 2015, un chirurgien soutenu par MSF dans le nord rural du gouvernorat de Homs témoigne de sa peur liée à la menace permanente d’attaques aériennes, mais aussi de sa volonté de rester pour assurer des opérations chirurgicales. « Je suis le seul chirurgien généraliste pour une population de 100 000 habitants. La majeure partie des chirurgiens ont fui. Cette situation est difficile sur les plans personnel et émotionnel. Je ne peux pas partir et abandonner tous ces gens alors que d’autres chirurgiens ne seraient pas autorisés à entrer dans la région. Mais je ne suis pas heureux ici. Ma femme et mes enfants sont constamment en danger. D’un côté, je ne suis pas épanoui dans cette situation, et de l’autre, je sais que toute une population a terriblement besoin de nous. »
En 2013 et 2015, l’organisation dénonce l’utilisation d’armes chimiques après avoir reçu un très grand nombre de patients présentant des symptômes d’exposition à des agents chimiques. Dix ans après le début du conflit syrien, MSF continue d’intervenir dans le pays et dans les camps de réfugiés notamment au Liban et en Jordanie.

Kobané, Syrie, 2015. Arin avec ses fils jumeaux. Elle est rentrée à Kobané il y a quatre mois.
© Lorenzo Meloni / Magnum PhotosSi les conflits modernes se caractérisent par leur complexité, les humanitaires et les photojournalistes cherchent avant tout à porter les regards et les voix. Ainsi, les faits sont incarnés. Au-delà des bilans chiffrés et des décomptes de victimes, les images et les récits documentent la violence de la destruction, de la perte. Personne ne pourra ensuite dire qu’il n’a pas vu, pas su.
Lors de la bataille pour reprendre Mossoul des mains de l’Etat islamique, quatre photographes Magnum sont dans la ville en 2016 et 2017 : Paolo Pellegrin, Jérôme Sessini, Lorenzo Meloni et Moises Saman.

Omar Qapchi, Irak, 2016. Fin octobre, les forces peshmerga ont pris d'assaut Omar Qapchi, un village situé à l'est de Mossoul. Après qu'un convoi blindé a encerclé une force d'environ une douzaine de combattants ISIS, les soldats kurdes ont poursuivi l'ennemi à pied dans les rues.
© Paolo Pellegrin / Magnum Photos
Mossoul, Irak, 2016. Des civils blessés sont soignés par les forces irakiennes après une attaque au mortier et à la voiture piégée par l’Etat islamique.
© Jérôme Sessini / Magnum Photos
Périphérie de Mossoul, Irak, 2017.
© Lorenzo Meloni / Magnum Photos
Hammam al-Ali, Irak, 2017. Des civils irakiens déplacés du côté ouest de Mossoul se rassemblent dans un camp informel à la périphérie de Hammam al-Ali, au sud de Mossoul.
© Moises Saman / Magnum PhotosL’offensive a duré neuf mois. Chaque rue et chaque maison ont été visitées, sécurisées et, au fur et à mesure, la ligne de front se déplaçait. Avec des milliers d’Irakiens blessés ou tués et plus d’un million de déplacés, cette bataille urbaine demeure l’une des plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. En attendant de pouvoir assurer un espace de travail sécurisé au cœur de la ville, MSF installe, dès février 2017, une unité mobile de chirurgie de guerre afin de soigner les personnes évacuées hors de la ville. Cette structure est restée pendant plusieurs mois celle la plus proche des combats se déroulant à Mossoul Ouest. Plus de la moitié des blessés de guerre de cette partie de la ville ont été soignés dans cette unité. Dès juin 2017, MSF commence à intervenir dans le quartier de Nablus, un point stratégique situé à environ trois kilomètres de la ligne de front. Les équipes prennent en charge les victimes directes du conflit dans le service des urgences et au bloc opératoire. L’hôpital de Nablus s’est transformé à ce moment-là en miroir brutal des horreurs que cette bataille a infligé aux habitants. En quelques semaines, les équipes ont réalisé quelques centaines d’interventions chirurgicales.
Trish Newport, coordinatrice de projet à Mossoul en 2017, raconte un moment de vie et de partage avec l’un des gardiens MSF. « La première fois que j'ai rencontré Mahmoud, il marchait sur la route de Mossoul Ouest. La guerre faisait rage à moins de deux kilomètres de là. Il marchait en portant un plant de menthe dans ses bras. Mon équipe et moi étions à la recherche d'une grande salle pour établir une unité de stabilisation des blessés. Nous voulions être proches de la ligne de front, pour augmenter les chances de survie des patients lors de leur transfert en ambulance jusqu'à l'hôpital. Mais les grandes salles étaient difficiles à trouver - la plupart des grands bâtiments avaient été détruits pendant la guerre. Nous avons arrêté Mahmoud sur le bord de la route et lui avons demandé s'il savait où nous pourrions trouver une grande salle. Il nous a montré différents bâtiments et à chacune des visites, il avait toujours son pot de menthe avec lui. Une fois que nous avons choisi l'endroit pour notre clinique, nous avons engagé Mahmoud comme gardien. Tous les jours, il venait travailler avec sa menthe. Pendant les deux dernières années et demie passées, Mahmoud et sa famille avaient vécu à Mossoul, sous l'Etat islamique. Pendant l’occupation, il avait appris à ses enfants à faire pousser des plantes et sa plus jeune fille a fait pousser une menthe. Lorsqu'il a envoyé ses enfants dans le camp de déplacés, elle lui a demandé de s'occuper de sa plante. Il lui a promis de la garder avec lui jusqu'à son retour. Et il l'a fait. Cette plante nous a tous mis à l'abri. Les jours où les bombardements ou les combats étaient vraiment intenses, je regardais à l'extérieur de la clinique pour voir Mahmoud assis calmement dans son abri avec la plante sur ses genoux. Quand j’ai fini ma mission, Mahmoud m'a apporté des graines de menthe et il m'a demandé de les planter chez moi, au Canada, ainsi les plantes pourraient avoir une vie meilleure. »
Si en zone de conflit, les humanitaires et les photographes cherchent à appréhender la réalité dans toute sa complexité, ils survivent aux mêmes situations extrêmes que les civils. Quel que soit le contexte, ils veulent être là, auprès des populations, et remplir leur mission de témoignage. Au-delà de la détresse et de la souffrance, leur action peut-être surtout le miracle de la survie et du souvenir qui restera, une trace indélébile.
Les derniers photoreportages


Grèce, l’impasse aux portes de l’Europe par Enri Canaj, 2020

Soudan, réfugiés à la frontière par Thomas Dworzak, 2020

Honduras et Mexique, l’espoir au bout de la route par Yael Martínez, 2021

RD Congo – Ituri, une lueur à travers la fêlure par Newsha Tavakolian, 2021

Mossoul, les oiseaux volent à nouveau par Nanna Heitmann, 2021