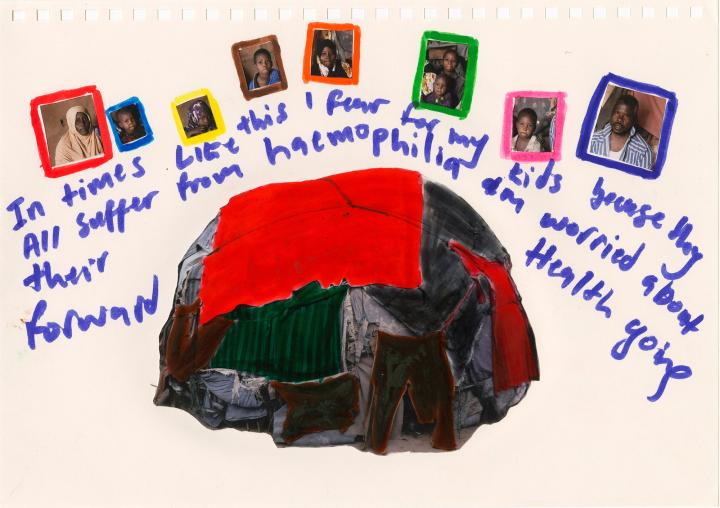Déplacés ou réfugiés, fuir pour survivre

Réfugiés rwandais dans le camp de Ngara, à proximité de la frontière. Tanzanie, 1994
© Gilles Peress/ Magnum PhotosLors de flambées de violence, l’instinct de survie pousse les populations à fuir vers les régions ou les pays voisins. Les sites d’arrivée ne sont pas préparés pour accueillir ces afflux de familles, alors rapidement, la vie dans les camps informels doit s’organiser. Les humanitaires, s’ils ne sont pas déjà sur place, arrivent dans les premiers jours de cette urgence, de même que les photographes. Si les conditions de vie y sont très difficiles et les contraintes nombreuses, l’essentiel reste de préserver ou restaurer une certaine dignité pour les individus pris en otage dans cette situation sur laquelle ils ne peuvent pas agir.
Trouver refuge dans des camps
Fuir une situation de crise signifie d’abord partir en laissant tout derrière soi. Une fois arrivé dans un endroit un peu plus sûr, il s’agit dans un premier temps, d’organiser la survie, c’est-à-dire se construire un abri et avoir accès à l’eau et la nourriture ainsi qu’à un minimum d’hygiène. Au milieu du chaos et de la douleur d’avoir tout perdu, l’hôpital et les humanitaires constituent une lueur d’espoir. Au fil des jours, le quotidien et l’entraide s’organisent pour retrouver une certaine normalité que l’objectif des photographes saisit.

Cambodge, 1975
© Hiroji Kubota/ Magnum PhotosDans les années 1970, les régimes oppressifs qui sévissent au Cambodge et au Vietnam poussent un million de personnes à fuir vers la Thaïlande voisine. C’est la première expérience MSF dans des camps de réfugiés. Sous l’enregistrement d’autres ONG, les volontaires MSF travaillent dans les camps d’Aranyaprathet et Ban-Vinaï, puis ceux de de Nam Yao et Chieng-Kong, des campements informels qui deviennent des camps officiels au fil des ans. Les médecins sont envoyés là où s’installent les flots de réfugiés, qui sont sans accès à l’eau, aux sanitaires et vivent dans la promiscuité la plus totale.
En 1976, Claude Malhuret est en mission dans le camp d’Aranyaprathet qui abrite 7 000 réfugiés. Il raconte : « Personne ne connaissait alors vraiment les camps de réfugiés. Il n’existait aucun corps de doctrine médicale à ce sujet, aucune littérature, aucune définition sur laquelle s’appuyer. J’ai vu ces hommes, ces femmes et leurs gosses, et, en les écoutant, j’ai compris peu à peu l’étendue de l’horreur qui se jouait là-bas, côté Khmers rouges. Des survivants traqués, visages hagards, membres enflés, gonflés par le béribéri [déficit en vitamine B1], il fallait leur arracher les mots. La plupart, terrorisés, s’effondraient en sanglots à la moindre question. »

Thaïlande, 1980
© Steve McCurry/ Magnum PhotosFace au manque de matériel et de personnel dans les camps en Thaïlande, et afin de répondre aux besoins des réfugiés, MSF prend conscience de la nécessité de créer une structure solide et organisée, s’appuyant sur une logistique. Dès 1977, Claude Malhuret, de retour de mission en Thaïlande, le soulignait : « Le monde d’aujourd’hui et celui de demain sera celui des réfugiés. MSF devra donner à ses volontaires les moyens efficaces d’affronter techniquement cette réalité nouvelle. » Grâce au pharmacien Jacque Pinel, la structure logistique de MSF est née à ce moment-là, dans les camps de Sakéo et Khao I Dang.
Main dans la main avec les populations réfugiées, les volontaires MSF tentent de réorganiser la vie dans le camp. Chacun prend sa part en devenant auxiliaires de soin, aides-soignants, infirmiers. « Ils assuraient l’encadrement sanitaire du camp, recensaient les nouveaux malades, dirigeaient les plus atteints à l’hôpital, explique Esméralda Luciolli, médecin MSF en mission dans le camp de réfugiés de Surin en 1979. Ces sentinelles de l’hygiène réussissaient, organisaient les équipes de ramasseurs d’ordures, ils apprenaient aux femmes à faire bouillir l’eau, aux enfants à se servir des latrines. »
Abonnez-vous à la newsletter MSF

Yves Coyette, médecin MSF, dans le camp de réfugiés de Khao I Dang. Thaïlande, 1984
© Burt Glinn/ Magnum PhotosLa première mission de Rony Brauman est aussi dans les camps thaïlandais. En octobre 1979, il se souvient de son arrivée à Ta Prik, à la frontière nord du Cambodge où 30 000 réfugiés viennent de traverser : « Nous avons fait irruption face au spectacle le plus terrifiant qu’il m’ait été donné de voir… Des dizaines de milliers de gisants, effondrés sur eux-mêmes, une masse sombre, compacte, agglutinée dans ce coin de savane. Pas un bruit, pas un seul mot ni même un pleur d’enfant. Des râles seulement, des quintes de toux, le froissement du vent, les cris étouffés des animaux, au loin… »
Seuls les survivants sont arrivés, car il est toujours impossible de traverser la frontière. L’aide ne peut pas entrer au Cambodge. Il devient impératif pour une partie des volontaires de pouvoir apporter une assistance au plus près des besoins et non plus à la périphérie. C’est pourquoi en février 1980, devant le pont frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge, MSF organise une marche symbolique avec des médias internationaux et d’autres ONG pour que des convois de nourriture entrent dans le pays. Devant les caméras du monde entier, Claude Malhuret prend la parole : « Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière, risquent d’un jour à l’autre d’être repoussés et d’être soumis aux feux des militaires. Nous sommes ici pour demander que soient préservées ces vies civiles, les vies de gens désarmés. Nous vous adjurons pour l’heure, soldats qui nous faites face, d’admettre sur le sol cambodgien ces camions de vivres, de médicaments, ces équipes de médecins qui demandent le simple droit de porter assistance aux survivants d’une longue, trop longue tragédie. Assise à quelques mètres, notre délégation, représentante de millions et de millions de consciences bouleversées par ce qu’elles pressentent de la situation au-delà de cette frontière, attendra tout ce jour votre réponse et votre autorisation.
Sans surprise, ils sont refoulés par le régime en place. Malgré l’échec, l’opinion publique est alertée de la situation des réfugiés grâce à une importante couverture médiatique.
Quelques années plus tard, en 1994 puis 1996, les violences secouent l’Afrique centrale, loin des caméras et des écrans du monde entier. Pour tourner un film documentaire intitulé Afriques : comment ça va la douleur ?, le photographe Raymond Depardon a passé cinq mois à parcourir le continent africain depuis le Cap, en Afrique du Sud, jusqu’à Alexandrie, en Egypte. Le titre fait référence à l’une des phrases dont l’apostrophaient les révolutionnaires tchadiens pendant son long séjour là-bas, la douleur étant ici utilisée avec légèreté, comme un élément inhérent au quotidien. Les images qu’il réalise sont accompagnées de petits textes écrits et lus par le cinéaste lui-même qui ne sont pas des commentaires mais le regard qu’il pose sur chaque contexte et la compréhension qu’il en a. Lors de ce périple, Raymond Depardon a croisé les équipes MSF au Burundi, alors déchirée par une guerre civile. Il a photographié les familles déplacées qui vivaient dans des tentes et à qui manquait l’accès aux biens vitaux. MSF travaillait dans les camps pour prendre en charge la malnutrition et les pathologies causées par les conditions de vies insalubres et le manque de nourriture. L’organisation soutenait aussi les hôpitaux de référence des différentes provinces.


Même au milieu des situations les plus tragiques, Raymond Depardon choisit de laisser parler les images. « Je ne parcours pas le monde, je ne fais pas des photos pour ça. Cela m’est arrivé de faire quelques photos fortes comme ça, mais je fais comme tout le monde. Je suis quelques fois horrifié, mais quelques fois, ce que je vois me sort aussi des idées préconçues que je peux avoir : d’un côté les bons, de l’autre, les méchants. Il faut faire attention. Et quelques fois, il faut laisser faire : les photos peuvent aussi nous rediriger un peu. » Et c’est la dignité qui est au cœur du travail du photographe.

Poste frontière de Sahela, entre la Syrie et l’Irak, 1er novembre 2019. Des bus sont affrétés pour transporter les réfugiés kurdes du nord-est de la Syrie jusqu’au camp de Bardarash, dans la province de Dohuk, au Kurdistan irakien. Iraq, 2019
© Moises Saman/ Magnum PhotosLes offensives et autres flambées de violence continuent de faire fuir les populations. Plus récemment, en 2019, l'enclave syro-kurde du Rojava située le long de la frontière turque, dans le nord-est de la Syrie est pilonnée par l’armée turque. Cela occasionne l’arrivée de plus de 12 000 réfugiés au Kurdistan irakien.
« Immédiatement après le début des combats dans le nord-est de la Syrie, nous avons fait une rapide évaluation des différents points d’entrée à la frontière entre l'Irak et la Syrie, dont les sites d'accueil et les camps où des réfugiés allaient être accueillis », explique Maruis Martinelli, coordinateur de projet MSF à Bardarash, le camp où se sont installés les réfugiés. Le photographe Moises Saman y était aussi dès le début.
Les besoins urgents sont notamment du côté de la santé mentale : « Durant le premier jour passé sur place, la plupart des personnes dépistées par notre équipe de santé mentale présentaient des signes d'anxiété et de dépression », dit Bruno Pradal, responsable MSF en santé mentale.


Des équipes mobiles, constituées d’agents de santé locaux originaires de la région, sillonnent les tentes du camp pour rencontrer les familles, identifier les symptômes et dispenser les premiers soutiens psychologiques. Jamal et Jalal, tous deux travailleurs de santé communautaire et interprètes MSF, ont fait la douloureuse expérience de la vie de réfugié lors de l’occupation de leur région par le groupe Etat Islamique en 2014. « Nous avons fui dans les montagnes, raconte Jalal. Puis, avec certains de mes proches, nous sommes passés par la frontière syrienne avant de prendre la direction de Dohuk, au Kurdistan irakien. » Et Jamal de préciser : « En tant qu’ancien réfugié, nous savons ce que ces gens peuvent ressentir dans ces moments, car nous en avons vécu des expériences similaires. Mon travail aujourd’hui consiste à visiter les tentes afin de rencontrer les familles et identifier les symptômes de traumatismes psychologiques afin qu’ils puissent être pris en charge. » Et au milieu des tentes et des collines, le photographe Moises Saman a saisi les moments de liberté qu’essaient de retrouver les enfants du camp.

Les enfants jouent au foot dans le camp de Bardarash. Irak, 2019
© Moises Saman/ Magnum PhotosSi, pour les réfugiés, retrouver une certaine sécurité dans un camp semble logique, cela ne va pas toujours de soi. Être auprès des déplacés et des réfugiés nécessite de devoir s’adapter aux contraintes imposées par les autorités officielles et non officielles, et, quand les conditions ne sont plus acceptables, il faut choisir de partir.
Les limites de l’assistance

Camp de réfugiés rwandais dans la région de Ngara, près de la frontière avec le Rwanda. Tanzanie, 1994
© Gilles Peress/ Magnum PhotosLe 6 avril 1994, l’avion du président du Rwanda est abattu à son arrivée à Kigali. Dans les jours qui suivent l’attentat, les premières tueries de Rwandais Tutsis se produisent. D’avril à juillet 1994, entre 500 000 et un million de Tutsis sont victimes d’une extermination systématique. Ce génocide est l’aboutissement de stratégies anciennes menées par des groupes politico-militaires extrémistes qui ont excité les ressentiments ethniques contre la minorité Tutsi. Au cours de cette période, un très grand nombre de Hutus opposés aux massacres ont été tués par les mêmes criminels. Le 13 avril 1994, une équipe d’urgence MSF composée de cinq volontaires expérimentés, dont Jean-Hervé Bradol, arrivent à Kigali, la capitale du Rwanda, afin de renforcer l’équipe présente depuis 1993. Il dit son incompréhension à son arrivée : « Les morts sont plus nombreux que les blessés. Pourtant les armes utilisées, des machettes, ne peuvent pas être qualifiées d’arme de destruction massive. L’assassinat systématique des Tutsis et des Hutus suspectés de ne pas soutenir les tueurs finit par nous convaincre que seule une incroyable volonté politique peut produire un tel résultat. »

Près de la frontière du Rwanda, à Goma. Zaïre, 1994
© Gilles Peress/ Magnum PhotosAprès avoir documenté les horreurs de l'épuration ethnique en Bosnie, le photographe de l'agence Magnum Gilles Peress s'est rendu au Rwanda pendant le génocide. Il analyse : « L'immensité de ce crime dépasse notre imagination et n'est surpassée que par l'incroyable indifférence de l'Occident et des nations développées qui auraient pu intervenir et empêcher ce crime... » Pour cette raison, il intitule son livre The Silence publié en 1995 en référence au silence de la communauté internationale. L’ouvrage rassemble son travail dans ce contexte. Le journaliste Philip Gourevitch, était envoyé spécial au Rwanda pour Paris Review. Il note à propos des clichés de Gilles Peress : « Ce que vous voyez ici, dans les photographies de Gilles, n'existe que parce qu'il a pris ces images, et parce que vous les regardez. Ce qui s'est passé à l'époque n'est plus qu'un souvenir. C'est la vie, et la vie, ce sont des voix. Le Rwanda est plein de voix, et les voix sont pleines de mémoire. »

Un hôpital près d'un camp à Kabgayi. Rwanda, 1994
© Gilles Peress/ Magnum PhotosFace à ce massacre, les volontaires internationaux ne peuvent protéger les membres de leur personnel local et leurs patients qu’ils savent pourtant en danger. Quand la mission est évacuée vers le Burundi voisin, le personnel rwandais est refoulé à la frontière. De retour à Paris, Jean-Hervé Bradol, responsable des programmes MSF au Rwanda, rend compte de l’atrocité en cours. MSF décide de prendre la parole. L’organisation convoque une conférence de presse et le message est publié dans le journal Le Monde du 18 juin 1994. « Nous en sommes aujourd’hui les témoins directs. Les listes, soigneusement établies, des personnes à tuer ont été distribuées dès le premier jour. On tue sur ordre, on « nettoie » maison par maison. Les auteurs de ces massacres sont connus : il s’agit de milices dirigées par l’entourage du dictateur défunt. Après le secrétaire général de l’ONU, le Conseil de sécurité des Nations unies a reconnu qu’un génocide était en train de se dérouler. Aujourd’hui, les mots sans les actes deviennent indécents. Un génocide appelle une réponse radicale, immédiate. La seule réponse apportée à ce jour relève du secourisme. On n’arrête pas un génocide avec des médecins ! » Après d’intenses débats internes sur le choix de rompre la neutralité humanitaire, MSF appelle à une intervention armée internationale. C’est « l’opération Turquoise » par l’armée française, qui sauve des vies, mais facilite aussi le repli des forces armées rwandaises vers le Zaïre.
Des centaines de milliers de Rwandais ont fui à la fois sous la menace, sous l’influence de la propagande officielle et par crainte des exactions des milices. Ils s’arrêtent dans des camps en Tanzanie et au Zaïre. Les humanitaires sont là pour offrir un accès aux soins.


Pendant l’été 1994, MSF se mobilise pour combattre le choléra qui touche les réfugiés au Zaïre. Mais très rapidement, l’épidémie contrôlée, les volontaires se trouvent confrontés à l’emprise brutale des leaders sur la population des camps, dont certains sont transformés en base arrière pour la reconquête du Rwanda. L’aide est massivement détournée et les réfugiés sont victimes de menaces et d’exactions.
Si les humanitaires sont tous révoltés par la situation, ils sont divisés quant aux moyens d’y remédier. Certains pensent que MSF doit cesser ses activités dans les camps, d’autres qu’il existe encore une marge de manœuvre pour améliorer la situation, d’autres encore que MSF doit rester aussi longtemps que les réfugiés ont besoin de secours, quel que soit le contexte. En novembre 1994, un appel des ONG présentes dans les camps du Kivu, au Zaïre, est adressé au Conseil de sécurité des Nations unies, demandant l’envoi d’une force de police internationale pour séparer les réfugiés des « cadres responsables » du génocide. L’appel reste sans suite. Dès lors, dans une tentative de réponse commune, le mouvement MSF se trouve confronté au problème suivant : continuer le travail dans les camps, c’est-à-dire renforcer l’emprise d’un pouvoir génocidaire sur la population ou se retirer, c’est-à-dire renoncer à aider une population en détresse. La phase d’urgence passée, l’organisation choisit de cesser ses activités et, en l’absence d’amélioration de la situation, quitte les camps entre 1994 et 1995.

Camp de réfugiés rwandais dans la région de Ngara, près de la frontière avec le Rwanda. Tanzanie, 1994
© Gilles Peress/ Magnum PhotosLaisser la place, écouter et tenter de comprendre la complexité

Planche contact des photographies de Jean Gaumy dans le camp de Mesa Grande. Honduras, 1985
© Jean Gaumy/ Magnum PhotosLes années 1980 sont les théâtres de conflits intenses en Amérique latine et centrale, en particulier au Honduras, Salvador, Guatemala et Nicaragua. Les guérilleros s’opposent aux gouvernements autoritaires, créant une situation de guerre civile et les populations, quand elles ne sont pas prises au piège, fuient vers les pays voisins. Elles s’installent alors dans d’immenses camps informels ou directement dans les communautés hôtes. Tout le long des 200 km de frontière entre le Salvador et le Honduras, ce sont plus de 15 000 réfugiés salvadoriens qui sont massés. En juillet 1980, MSF commence à travailler dans le camp de Mesa Grande au Honduras, situé à une cinquantaine de kilomètres de la frontière. Il s’agit d’une équipe de trois médecins et deux infirmières MSF qui organisent d’abord des cliniques mobiles dans les villages alentours où se cachent les réfugiés traumatisés par leur expérience au Salvador. Dans le centre de santé, ils soignent les pathologies dues aux conditions de vie désastreuses. La structure devient ensuite un petit hôpital de quatre pièces incluant une maternité.

Camp de réfugiés de Mesa Grande. Membres de MSF.
© Jean Gaumy/ Magnum Photos
Planche contact des photographies de Jean Gaumy dans le camp de Calle Real. Salavdor, 1985
© Jean Gaumy/ Magnum PhotosEn 1984, Xavier Emmanuelli, président MSF sortant vient en visite dans les missions du Honduras, du Salvador, du Nicaragua et du Guatemala. Il emmène avec lui un journaliste : Claude Mauriac, et un jeune photographe de l’agence Magnum : Jean Gaumy. L’humanitaire souhaitait un regard externe à celui de l’organisation qu’était MSF à ce moment-là, il reste d’ailleurs convaincu, 40 ans plus tard, de l’importance de la narration faite par les photographes, car seules les images subjectives des photographes apportent la dimension humaine de la mission humanitaire. Xavier Emmanuelli précise : « Jean Gaumy comprenait cela ! Car une fois sa mission finie avec nous, il est reparti à ses propres frais pour finir le travail qu’il avait commencé. Jean a son propre récit d’images qui saisissent un moment d’universalité, c’est-à-dire que quoi qu’il arrive et où que cela se passe, ce sont les codes de l’humanité qui sont là sur les photos. Parce que Jean a de l’affection pour les personnes qu’il photographie. Sa manière de regarder est impliquée, engagée. »

Camp de réfugiés de Mesa Grande. Honduras, 1985
© Jean Gaumy/ Magnum PhotosJean Gaumy se souvient de l’importance de ce reportage dans son parcours de photographe. « Ce voyage a été initiatique. Je découvrais, je rencontrais des volontaires MSF qui racontaient le terrain et à travers leurs histoires, ils disaient le courage de leurs choix. On est transformé au fur et à mesure de chaque mission. Et photographe comme humanitaire, face aux réalités des crises que l’on voit, on n’est rien, on est dépassé, et c’est cela qui nous ramène à une espèce d’humanité. »

Kosovo, 1999
© Cristina Garcia Rodero/ Magnum PhotosQuelques années plus tard, en 1999, alors que les exactions à l’encontre des populations albanaises au Kosovo se poursuivent, la photographe Cristina Garcia Rodero se rend aux côtés des déplacés et des réfugiés kosovars. Elle raconte : « Lorsque j'ai appris que les Albanais kosovars étaient expulsés de leur pays, j'étais au Mexique, mais je me suis immédiatement rendue sur place. Je savais où était Skopje et où était la frontière et j'y suis allée. Ensuite, il s'agissait de se rendre dans les camps de réfugiés et d’échanger avec eux. »

Albanie, 1999
© Cristina Garcia Rodero/ Magnum PhotosLes humanitaires sont aussi présents au Kosovo. Keith Ursel, le coordinateur d’urgence MSF au Kosovo en 1998, alerte sur la difficulté d’opérer et sur la situation critique des déplacés. « Ces gens souffrent tellement, dit-il. Non seulement ils n’ont pas de médicaments mais maintenant même ceux qui les soignent sont ciblés. L’hiver approche et au Kosovo, les températures baissent à des niveaux dangereux. Environ 200 000 personnes sont déplacées. Parmi elles, des milliers vivent dans les bois, avec très peu d’assistance. »
Après l’échec des négociations pour mettre fin à la guerre au Kosovo, l’OTAN lance l’opération « Forces alliées ». Les frappes aériennes commencent. MSF évacue le pays mais continue de travailler dans les camps de réfugiés en Albanie, au Monténégro et en Macédoine.
Dans le communiqué de presse du 1er avril 1999, MSF annonce : « Ce matin, un avion DC-8 est parti d’Ostende en direction de Tirana et un autre appareil a quitté Amsterdam pour Skopje, en Macédoine. A bord des deux appareils se trouvent en tout 50 tonnes de matériel médical, de couverture, de tentes et de bâches en plastique, de réservoirs d’eau et de pompes. Quatre volontaires se trouvaient dans l’avion allant à Skopje et trois dans celui de Tirana afin de renforcer les équipes déjà sur place. »

Macédoine, 1999. Camp de réfugiés à Stenkovac
© Cristina Garcia Rodero/ Magnum Photos« Les enfants jouaient, ce qui montre la capacité des êtres humains à s'adapter aux circonstances terribles dans lesquelles ils vivent, poursuit la photographe. Ces enfants me poursuivaient pour jouer avec moi. Où que j'aille, ils me suivaient pour me provoquer et le petit garçon a été blessé, et sur la photo, les enfants le réconfortent. Ses compagnons étaient aussi petits et, lorsqu'ils ont mis leurs bras à la fenêtre pour me saluer, le plus jeune s'est fait mal et les autres l'ont tendrement soigné et réconforté, car il s'était mis à pleurer. » A travers cette mission qui l’a marquée, elle précise le sens du travail du photographe : « Ce qu'il faut faire, c'est partager et avoir envie de raconter des choses. C'est savoir ce qu’on veut raconter, où on veut aller et pourquoi on y va, ce qu’on veut en faire, quelle est la mission, quel est le but ? Et chercher, chercher patiemment. Et si tu ne trouves pas, alors il faut revenir, une année et une autre. Et ne pas se décourager. C'est à ce moment-là que se produisent des choses qui ne peuvent pas arriver si on les imagine. »


Depuis le mois d’août 2017, des centaines de milliers de Rohingya victimes de violences ont fui le Myanmar vers le Bangladesh voisin. « Avant d'atteindre la terre ferme, la plupart des réfugiés débarquent sur les berges boueuses et peu profondes, raconte Moises Saman allé photographier les réfugiés qui continuaient d’arriver à l’automne. Ils se frayent ensuite un chemin dans la végétation en transportant les quelques effets personnels qu'ils ont pu prendre avec eux. »
Un père de 49 ans rapportait à MSF : « J’ai fui ma maison avec toute ma famille, mais mon fils a reçu une balle alors qu’il courait. Je l’ai emmené à l’hôpital, ici, au Bangladesh, mais j’ai dû laisser le reste de ma famille dans une forêt au Myanmar, sans abri, juste cachée. Je n’ai pas eu de leurs nouvelles depuis des jours. Je ne sais quoi faire, je suis vraiment désespéré. »
La plupart des familles s’installent dans des camps de fortune à Cox’s Bazar, dénuées d’abris, de nourriture, d’eau potable ou de latrines. Les structures médicales mises en place en urgence par MSF et d’autres organisations sont rapidement été débordées. Konstantin Hanke, médecin MSF, était sur place. Il témoigne : « 515 000 réfugiés en cinq semaines peut sembler un chiffre abstrait, mais en tant que médecin ici, je vois ce que cela signifie réellement. Les gens ont profondément besoin d'aide. Une dose supplémentaire de malchance et on aura une épidémie sur les bras. »
Abonnez-vous à la newsletter MSF

Yasmin, 21 ans, réfugiée Rohingya, et son fils Mohamed, 5 ans, souffrant d'une forte fièvre, sont assis sur un lit à la clinique MSF de Kutupalong. Bangladesh, 2017
© Moises Saman/ Magnum PhotosA la suite de sa visite dans le camp de Cox’s Bazar, la présidente international Joanne Liu a pris la parole lors d'une conférence organisée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. « Il est difficile d’imaginer l'ampleur de la crise sans l’avoir vue de ses propres yeux. Les réfugiés vivent dans des camps extrêmement précaires, composés d’abris de fortune éparpillés sur de petites collines, faits de boue et de bâches plastiques, fixés par du bambou. Ne perdons pas à l’esprit que la cause du déplacement des Rohingya est la crise actuelle au Myanmar. Les gens ont fui parce que leur vie était en danger, ils n'ont eu d'autre choix et des centaines de milliers d'entre eux sont toujours piégés au Myanmar. Ceux-ci subissent encore cette terreur et sont désormais coupés de l'aide humanitaire. »
Des études faites par MSF dans des camps de réfugiés au Bangladesh estiment qu’au moins 9 000 Rohingya sont morts au Myanmar, dans l’Etat de Rakhine, entre le 25 août et le 24 septembre. « Nous avons rencontré des personnes qui ont réchappé des violences au Myanmar et nous avons parlé avec elles, explique Sidney Wong, directeur médical MSF. Ce que nous avons mis au jour est terrible, à la fois pour ce qui est du nombre de personnes qui ont dit avoir eu un membre de leur famille mort à cause de la violence et pour la manière atroce dont, selon elles, ils ont été tués ou grièvement blessés. Le pic des décès coïncide avec le lancement des opérations dites d’évacuation par les forces de sécurité du Myanmar la dernière semaine d’août. » Les conclusions de cette étude sont sans appel : les Rohingya sont la cible volontaire des exactions en cours au Myanmar.
En repensant à son voyage plusieurs semaines après son retour, Moises Saman garde en tête les choses dont il a été témoin. « En général, ce sont les personnes les plus vulnérables que j'ai vues – hommes et femmes âgés, enfants et jeunes mères non accompagnées avec leurs enfants – qui me reviennent à l’esprit, déclare-t-il. Mais une pensée me taraude, c’est la façon dont la plupart d'entre nous, même après avoir été témoins directs de crises similaires dans différentes parties du monde, n’avons absolument aucun point de référence pour comprendre ce que c'est que d'être un réfugié. »

Des réfugiés éthiopiens se préparent à monter dans les bus qui les transféreront du camp de transit d'Al Hashaba au camp de réfugiés d'Um Rakuba. Soudan, 2020
© Thomas Dworzak/ Magnum PhotosAujourd’hui encore, les flambées de violence forcent des populations entières à fuir leur foyer sur tous les continents, soient plus de 80 000 millions de personnes qui sont réfugiées ou déplacées. Contrairement aux idées reçues, 73 % d’entre eux le sont dans un pays voisin du leur. Les réfugiés éthiopiens au Soudan illustrent bien cette réalité. En effet, début novembre 2020, des combats ont éclaté au Tigré, dans le nord de l'Ethiopie, opposant des forces armées régionales à l’armée nationale d’Abbis-Abeba. 60 000 personnes se sont réfugiées de l’autre côté de la frontière et des centaines de milliers ont été déplacées à l'intérieur du Tigré. Côté soudanais, MSF était à pied d’œuvre dès les premières arrivées pour apporter un soutien et une assistance médicale aux réfugiés. En décembre, le photographe Thomas Dworzak s’est rendu dans la région d’Al-Gedaref pour rencontrer les réfugiés. Cet afflux est loin d’être une situation inédite, la région ayant déjà connu des vagues de réfugiés éthiopiens lors de la crise humanitaire de 1985. 30 ans plus tard, les anciens camps de réfugiés des alentours sont devenus des lieux de vie et la population éthiopienne qui y habite est désormais intégrée.
-> L'intégralité du photoreportage de Thomas Dworzak au Soudan

Fin de la journée dans le village d'Al Hashaba, l’un des points d’entrée des réfugiés éthiopiens. Soudan, 2020
© Thomas Dworzak/ Magnum PhotosLes derniers photoreportages


Grèce, l’impasse aux portes de l’Europe par Enri Canaj, 2020

Soudan, réfugiés à la frontière par Thomas Dworzak, 2020

Honduras et Mexique, l’espoir au bout de la route par Yael Martínez, 2021

RD Congo – Ituri, une lueur à travers la fêlure par Newsha Tavakolian, 2021

Mossoul, les oiseaux volent à nouveau par Nanna Heitmann, 2021