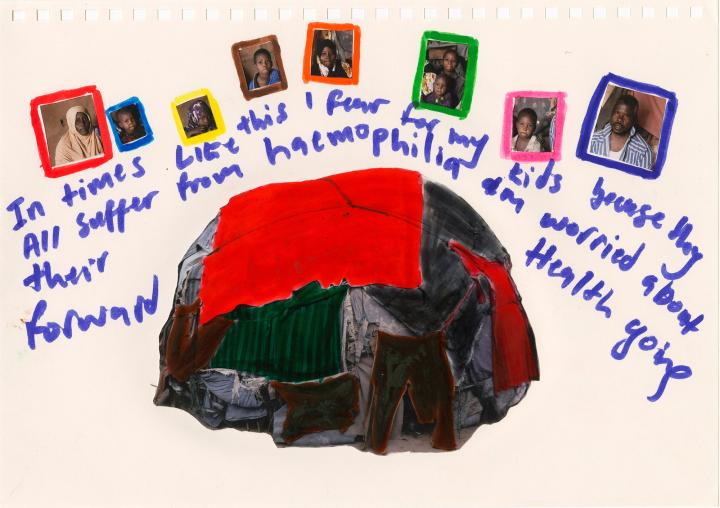Ituri, une lueur dans la fêlure

Manyotsi, 32 ans, porte dans ses bras son fils de 6 mois. Il a été conçu lors d’un viol. Elle dit qu’elle aime son enfant malgré tout car il est innocent.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosPar Newsha Tavakolian, RD Congo, 2021 – co-écrit par Sara Kazemimanesh
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, plus d’un million de personnes sont déplacées à cause de l’escalade de violence qui sévit depuis 2017. Pillages, incendies et exactions ont contraint les familles à quitter leur foyer et trouver refuge dans des camps offrant à peine plus de sécurité. Les déplacés doivent également faire face aux épidémies, aux multiples infections dues au manque d’hygiène, ainsi qu’aux violences sexuelles. Ils dépendent de l’aide pour survivre, mais rares sont les organisations sur place. La photographe Newsha Tavakolian s’est rendue en Ituri pour documenter la réalité des femmes déplacées et la violence quotidienne à laquelle elles sont confrontées.
En route pour Drodro
« Dans une demi-heure, c’est l'équinoxe de printemps – Nowruz–, c’est-à-dire le nouvel an perse. On dit que ce que vous faites au moment précis où le soleil se trouve juste au-dessus de l'équateur céleste détermine le déroulement de votre vie au cours de l'année à venir. Moi, mandatée par Médecins Sans Frontières, je suis assise dans une voiture en route pour Drodro, afin de documenter un projet sur les violences sexuelles. »
« Dans les voitures qui passent, ceux que nous croisons portent des couvre-chefs de fortune pour se protéger du nuage de poussière et de saleté soulevés par le mouvement des véhicules. Nous roulons sur cette piste boueuse qui s’enfonce sous les pneus, une route sinueuse qui se tortille, comme des serpents qui muent.
Nous nous arrêtons encore une fois à un poste de contrôle, évitant les yeux injectés de sang des soldats des groupes armés non étatiques, dont certains ne sont que des garçons, vêtus de tenues militaires, portant les armes. Le dos d'un doigt calleux glisse le long de mon muscle, et je traque des yeux la lumière qui traverse l'unique fêlure horizontale du pare-brise. Le vacarme que font les cochons ne cesse pas. Je demande au chauffeur d’accélérer, pour que nous puissions les laisser derrière nous. La route se divise, l’un des chemins mène à une communauté Lendu, tandis que nous tournons à droite vers Drodro, qui abrite des milliers de personnes déplacées de l’ethnie Hema. La vie continue à l'extérieur des huttes. La seule image visible à perte de vue : la récolte et le séchage du manioc.

A Drodro, un camp de réfugiés de fortune, appelé Tsuya, est installé depuis de nombreuses années. Environ 20 000 personnes y vivent.
© Newsha Tavakolian / Magnum Photos
Trois jeunes adolescents debout dans un terrain juste derrière leurs huttes, dans le village de Drodro.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosNous arrivons au village, et bien que dimanche et la messe soient dans quelques jours, un groupe de personnes est rassemblé autour d'un Jésus crucifié sur une grande croix. Nous ne pouvons pas nous arrêter pour investiguer, car nous devons nous aller à l'hôpital de Drodro, où il est prévu que je rende visite aux mères souffrant de malnutrition et à leurs jeunes enfants.

Une croix a été placée près de la route principale de Drodro et attire les foules, chaque jour plus nombreuses. La raison : le pied cassé de la statute saignerait, un véritable miracle.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosSous les moustiquaires, les petits enfants gémissent et pleurent. Je rencontre une jeune fille qui ne sourit pas et, avec l'aide d'un des médecins, je lui demande de devenir mon assistante. Elle me tient la lumière pendant que je filme. A l'extérieur du bâtiment, des parents se sont réunis pour préparer, avec leurs maigres réserves de produits locaux – manioc, bananes et ananas –, les repas pour leurs proches hospitalisés.

De nombreuses femmes et enfants souffrent de malnutrition en raison du manque de nourriture.
Malgré la richesse de ses ressources naturelles – pétrole, diamants, cobalt et or notamment –, la majorité de la population de la République démocratique du Congo (RDC) est extrêmement pauvre. Des millions de personnes sont déplacées et quotidiennement exposées à des violences physiques et sexuelles. Ces exactions sont perpétrées par des membres de milices, dont l'impunité pousse des civils – particulièrement des hommes – à commettre des actes similaires, et les principales victimes sont des femmes et des enfants.


Dans la région de l'Ituri, dans le nord-est du Congo, le conflit est particulièrement intense entre les communautés de cultivateurs Lendu et les communautés d’éleveurs Hema. Lorsque trois jeunes Lendu blessés sont amenés dans le camp Hema par des membres MSF pour y recevoir des soins, des personnes de la communauté Hema réagissent et se rassemblent rapidement autour de la voiture MSF. Ils menacent l’équipe pour les dissuader de soigne des membres de leur tribu rivale ici, dans le camp. Finalement, l'équipe MSF a dû emmener ces trois blessés vers un autre hôpital pour éviter tout conflit.


Mama Justine - présidente de la SFVS (Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles), une coalition de femmes activistes qui soutiennent les victimes de violence sexuelle – me dit que la normalisation de la violence sexuelle n'est pas seulement le résultat de la situation politique instable au Congo. Elle m’explique que la culture sociétale favorise la réduction des femmes à des objets.
De toute évidence, il existait autrefois une tradition ancrée qui incitait les hommes à emmener la partenaire qu'ils désiraient et à l'enfermer dans une pièce, ce qui revient à la kidnapper, bien sûr sans son consentement, avant de parler à sa famille de leur éventuelle union. Mamma Justine me dit que la situation est encore compliquée à cause de fausses croyances et de superstitions qui sont utilisées pour justifier la violence sexuelle. Certains croient même que le fait d'avoir des rapports sexuels avec une fille vierge guérirait l'homme du VIH.

Route de Drodro, vue depuis l'intérieur d'un véhicule MSF.
© Newsha Tavakolian / Magnum Photos
Paysage à Drodro.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosDes conflits incessants

Portrait de trois hommes congolais à Drodro. Les frustrations causées par le chômage, le manque de moyens de production couplés à une culture sociétale extrêment misogyne entraine une normalisation de la violence sexuelle contre les femmes.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosLe Congo a été colonisé pour ses ressources naturelles par la monarchie belge. Nommé Etat indépendant du Congo lorsque qu’il est le territoire personnel du roi Léopold II de Belgique, il devient une colonie belge en 1908. En 1960, les protestations des Congolais, qui ont fini par se soulever, ont conduit à l'indépendance du pays. Mais cela n'a pas signifié la fin des conflits : chaos, coups d'Etat, insurrections n’ont pas cessé.
L'assassinat de Patrice Lumumba, le tout premier ministre légalement élu du Congo, a anéanti la possibilité de former un gouvernement central qui pourrait œuvrer dans l'intérêt du peuple congolais et peut-être, dans une certaine mesure, empêcher des décennies de conflits dans le pays. La dictature menée par le successeur de Lumumba, Mobutu Sese Seko, a duré 30 ans, avec l'aide des gouvernements des Etats-Unis et de la France. A la suite d'une invasion étrangère par des forces militantes rwandaises, la dictature a finalement été renversée par le chef rebelle, Laurent-Désiré Kabila, ce qui a entraîné la première guerre du Congo et d'autres conflits ont suivi.


La première guerre du Congo (1996-1997), également connue sous le nom de première guerre mondiale de l'Afrique, a commencé comme une guerre civile mais est rapidement devenue un conflit international impliquant le Soudan, l'Ouganda et l’Angola, ainsi que de puissances occidentales, notamment la France et les Etats-Unis. La deuxième guerre du Congo a commencé en août 1998 et s'est terminée officiellement en 2003, lorsque le gouvernement de transition de la RDC a pris le pouvoir. Pour autant, malgré la signature d'un accord de paix à ce moment-là, la violence continue dans différentes régions du pays, notamment dans l’est du Congo où se trouve l'Ituri. Bien qu'ayant débuté au début des années 1970, le conflit d'Ituri fait spécifiquement référence à l’épisode de violence qui a atteint son paroxysme entre 1999 et 2003.
Aujourd’hui, les tensions et l’usage des armes n’ont pas cessé.
Les agressions pour seule option

© Newsha Tavakolian / Magnum Photos
Le coucher de soleil est d'une beauté envoûtante lorsque je rencontre Giselle, une grande fille de 16 ans aux cheveux très courts, vêtue d'une chemise blanc cassé, d'une longue jupe et d'une paire de chaussure en plastique sur lesquelles est imprimé le mot « VIP ». Elle raconte qu'après avoir donné naissance à son plus jeune frère, sa mère a perdu la raison et a disparu. Une nuit de 2018, les rebelles ont attaqué leur village, tuant tout le monde, y compris son père. Giselle et ses huit petits frères et sœurs ont fait partie des rares survivants, elle allait donc le devoir de reprendre la charge de la famille. Il y a deux mois, alors qu'elle allait chercher de l'eau avec cinq autres femmes, Giselle marchait plus lentement car elle portait de lourds jerrycans. Elle s’est retrouvée à l’arrière du groupe. C'est alors que trois hommes armés, l’ont saisie et l'ont forcée à se déshabiller. Ils ont pointé une arme sur sa tête pour qu'elle ne crie pas pendant l'agression. Ils l'ont violée l'un après l'autre, les deux autres surveillant la route.
Abonnez-vous à la newsletter MSF
Couverte de bleues et en état de choc, Giselle s'est remise debout pour faire le reste du chemin à pied. Un homme sur une moto a vu sa difficulté et sa détresse et lui a proposé de la ramener chez elle. De retour au camp, une femme âgée a remarqué l'état de Giselle et, en l’entendant raconter son épreuve, l'a incitée à se rendre au centre de santé pour demander de l'aide. Pendant un certain temps après son agression, Giselle a été incapable de rester debout ou de marcher correctement, mais elle n'a pas eu d'autre choix que de continuer à s'occuper de ses petits frères et sœurs. Giselle me dit qu'après sa violente agression par trois hommes, qui était son tout premier rapport sexuel, elle ne veut plus rien avoir à faire avec les hommes. Elle s'est jurée de ne jamais se marier et de poursuivre ses études pour pouvoir s'occuper de ses frères et sœurs et aider les femmes de sa communauté. Elle exprime sa mélancolie et sa grande solitude, me disant qu'elle se sent si impuissante sans ses parents, et que sa mère lui manque tous les jours.
J'explore le village, émerveillée par la beauté qui m'entoure. Le ciel semble si vaste ici, tout en étant extrêmement proche de la terre, comme si l'on pouvait saisir les nuages de barbe à papa simplement en levant le bras. Une fois de plus, je me retrouve près du grand crucifix et de la foule toujours croissante qui se masse autour de lui. Je demande à quelqu'un la raison de ce rassemblement étrangement impromptu. On me répond que le pied droit de Jésus est cassé, un liquide cramoisi s'en écoule. La foule semble avoir cru que Jésus saignait. Je ne peux pas m'attarder autour du Jésus qui saigne, car je dois me rendre au centre de santé.
Au centre de santé
Je croise le docteur Jean-Claude au centre de santé de Drodro, où l'on soigne plus de femmes et d'enfants que ce qu’il est possible de faire. La structure de soins a été soutenue par ACF (Action Contre la Faim). Des membres Hema ont récemment incendié la base de l’ONG, brûlant les véhicules et forçant le personnel à évacuer avec l'aide de la MONUSCO (Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo). Aujourd'hui, ACF ne travaille plus dans la région, ce qui signifie que les femmes et les jeunes filles qui viennent au centre de santé n’ont plus accès gratuitement aux soins dont elles ont désespérément besoin.


Je demande au Dr. Jean-Claude si l’on peut communiquer en anglais. Il me répond que oui, dans une certaine mesure. Je lui demande s'il sait où je peux trouver quelqu'un qui travaille avec les victimes de violences sexuelles. Il me dit qu'il s'occupe lui-même de ces femmes depuis 10 ans, ajoutant que beaucoup d'entre elles sont agressées par des hommes qu'elles connaissent, pas nécessairement des miliciens, mais des membres de leur propre famille ou d'autres hommes de leur communauté.
Il n'y a pas grand-chose à faire dans ces camps. Les enfants sont à moitié nus, les plus âgés aident leur famille en travaillant dans les champs ou en allant chercher de l'eau. Ce sont les femmes qui assument le plus gros des responsabilités, qu'il s'agisse de l’approvisionnement en eau, en nourriture ou en bois de chauffage, ou du travail aux champs. La plupart des agressions sexuelles ont lieu pendant leurs déplacements pour subvenir aux besoins de leur famille.

Des jeunes filles posent sur le chemin qui mène au seul endroit où les personnes qui vivent dans le camp de Rho ou dans ses environs peuvent aller chercher de l'eau.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosLe docteur Jean-Claude me dit que la violence sexuelle est effectivement une arme de guerre, une arme de destruction massive, mais ces hommes utilisent et abusent également du corps des femmes pour exprimer leurs frustrations. « Mais pourquoi docteur ? Pourquoi font-ils cela ? » Il me dit que les hommes sont frustrés et impuissants, au chômage, privé de moyen de production, et qu'agresser les femmes est donc leur façon de revendiquer une certaine forme de pouvoir. Je pense à Nzale, qui a été agressée parce qu'elle n'avait pas les 500 francs congolais (moins d'un dollar américain) qu'on lui demandait.
Le contraste est si frappant : cette terre généreuse, fertile, riche en cultures tropicales et en flore magnifique, mais qui abrite une violence insondable. Je quitte le centre de santé après la promesse de Jean- Claude de me mettre en contact avec un humanitaire local qui travaille auprès des victimes d'agressions sexuelles. Il y a tant de femmes sur la place du marché, qui se déplacent, préparent de la nourriture, tandis que leurs jeunes enfants s'accrochent à elles – tandis que les quelques hommes qui sont là ne font pas grand-chose. Le Congo est comme ces belles femmes, violées en permanence, donnant à qui veut un morceau de sa robe, une part de son corps.


Je passe devant les filles habillées en uniforme d'écolière – chemises blanches et jupes bleu marine – qui marchent au coude à coude avec les garçons qui portent des piles de manuels scolaires. Ils marchent tous près des bois d'un vert profond. C'est la saison de la mousson et les feuilles de bananier brillantes dégoulinent encore de la pluie récente, et je ne peux m'empêcher de me demander qui, parmi la foule, peut déchaîner la violence sur ces filles ? Qui est la personne qui va les protéger, si cette personne existe ?
Le Dr Serge est un psychologue qui dirige un nouveau programme médical visant à améliorer le bien-être mental des victimes de violences sexuelles dans la région. Il travaille avec ces femmes depuis un an et me dit qu'en plus des deux émotions les plus courantes ressenties par ces femmes, à savoir la honte et la culpabilité, il y a ici deux réactions générales à l'expérience de la violence sexuelle : l'effondrement mental complet ou le déni afin d’oublier.
Je me souviens des mots du prêtre, lorsque je l'ai interrogé sur les femmes et les filles qui attendaient leur tour pour se confesser. « Pourquoi sont-elles ici, mon père ? Qu'est-ce qu'elles veulent si désespérément confesser ? » Le prêtre m’a répondu : « Il y a des choses qui les accablent et qu'elles ne peuvent dire à personne d'autre que Dieu ». Quelle ironie qu'elles lui demandent le pardon pour des crimes dont elles sont les victimes.



Dieudonné, 48 ans, prêtre de l'église catholique romaine de Drodro.
© Newsha Tavakolian / Magnum Photos« Mais les traumatismes ne s'effacent pas. Ils empoisonnent l'esprit et, au fil du temps, prennent toujours plus de place, sont toujours plus destructeurs », dit le Dr Serge. Je l'interroge sur les familles des victimes : « Est-ce qu'elles soutiennent ces filles ? » Il me dit que certaines le font, et que cela les aide à surmonter la honte inévitable qu'entraîne une agression. Mais la plupart des familles ont tendance à bannir les victimes, ne leur laissant d'autre choix que de vivre en exil dans des camps voisins ou même de demander de l'aide à la famille de leurs agresseurs. Comme elles doivent se sentir seules et effrayées, leur seul refuge étant de rester avec les mêmes personnes qui ont mis leur vie sans dessus dessous.
Je me tiens près de l'hôpital en attendant qu'on prenne ma température, pandémie oblige, et qu'on me laisse entrer. Le thermomètre cassé affiche toujours le chiffre 32, comme s'il indiquait la température d’un cadavre. J'entends des cris stridents et, en entrant, je vois des femmes, peut-être une dizaine, assises dans l'escalier et se lamentant, les bras tendus vers le plafond, pleurant un soldat tombé. Un autre soldat brandit son fusil et explique ce qui s'est passé. Mais mon interprète me dit qu'il les a entendus dire que le soldat s'était suicidé.


Au bout du couloir, les femmes se rassemblent autour du corps. Enveloppés dans des draps blancs, ses yeux et sa bouche sont fermés comme s'il était plongé dans un profond sommeil. Les femmes se jettent sur le corps et continuent de gémir. Quelques miliciens, amis du défunt, se joignent également à la foule, pleurant leur ami tombé au combat. Je n'ai aucun moyen d'identifier la véritable cause de la mort. Mais quelle différence cela ferait-il ? Ces gens ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient tendrement.
Au centre de santé, je rencontre Honorine, la travailleuse humanitaire locale de 48 ans, qui y travaille depuis trois ans. Honorine me montre un cahier rempli du nom des filles, me disant que chaque jour, au moins cinq ou six victimes, pour la plupart mineures et dont beaucoup sont enceintes, demandent de l’aide. Beaucoup de ces filles sont victimes d’abus de la part de leur propre mari. Honorine m’explique que dans les camps, on encourage les femmes à venir au centre pour recevoir des soins si elles sont agressées. La structure médicale propose des bilans de santé, ainsi que des soins pour prévenir ou prendre en charge les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Alors que nous marchons le long du couloir, je vois une salle bondée d'une quinzaine de femmes enceintes, qui attendent toutes leur tour pour être examinées par la seule sage-femme présente.
Je demande à Honorine pourquoi il y a tant de violences sexuelles. Elle partage l'avis du Dr Jean-Claude, selon lequel le viol est un moyen par lequel les hommes exercent leur pouvoir et se vengent de la cruauté de la vie. Pour les miliciens, bien sûr, le viol est un moyen d'enlever le pouvoir aux populations locales, de ternir l’honneur des hommes en violant leurs femmes. Je réfléchis à ce corps de la femme qui est le réceptacle de cet acte de vengeance. Beaucoup de ces femmes sont soumises à des abus supplémentaires en raison de la honte associée à leur agression. Beaucoup sont bannies de leur communauté.

Nzale, 30 ans, allongée sur les genoux d'Honorine, 48 ans. Honorine est une soignante chargée de donner les premiers soins et un soutien psychologique aux femmes victimes de viol. Nzale a été abusée par des rebelles alors qu'elle cherchait de la nourriture pour ses sept enfants et qu’elle n’avait pas l’argent que ses agresseurs lui réclamaient.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosJe tombe à nouveau sur le grand crucifix. Cette fois, en plus de son pied droit, il manque à Jésus ses deux bras. Mon interprète, Alphonse, me dit que l'ablation des deux membres supplémentaires est un acte intentionnel pour prouver à la foule que le liquide n'est pas du sang, mais le métal oxydé du squelette interne de la sculpture mélangé à l'eau de pluie. Je demande au prêtre, ce qu'il pense de ce Jésus qui saigne et de la foule qu'il a attirée. Il me répond que ce genre de superstition est dangereux pour leur communauté et qu'il a l'intention de mettre un terme à ce spectacle. Pendant l'office du dimanche, l'église étant remplie de paroissiens attentifs, le prêtre met en garde la foule contre les effets néfastes des fausses croyances et de la soumission à la superstition. Mais à l'extérieur, la foule rassemblée autour du crucifix semble ne pas se soucier de ce raisonnement. La fois suivante où je passe devant la grande croix, le Jésus mutilé et saignant a disparu, tout comme la foule qui l'entourait.
De retour au centre de santé, je rencontre Gracian, la sage-femme de 52 ans, qui travaille ici depuis 2010. Dans une pièce sombre aux murs bleus, Gracian est assise à un bureau couvert de papiers, de documents et de dossiers. La lumière de la petite fenêtre éclaire son espace de travail exigu tandis qu'elle appelle les futures mères une par une. Je lui parle des femmes enceintes et déplacées dont elle s'occupe. J’interroge Gracian « Quel est le problème le plus urgent pour ces femmes ? » Elle me dit qu'en ce moment, plus que tout autre chose, elles ont besoin de nourriture et de vêtements. La plupart d'entre elles n'ont qu'un seul habit – celui qu'elles portent sur elles – et lorsqu'elles tombent enceintes, leurs vêtements ne leur vont naturellement plus. Elles ne sont pas bien nourries, voire pas du tout, et par conséquent, elles donnent naissance à de petits bébés mal nourris.
Les femmes sont assises là, écoutant en silence, sans bouger ni faire grand-chose. Deux d'entre elles attirent mon attention car elles semblent extrêmement jeunes pour être enceintes. Il est impossible de savoir qui est enceinte à la suite de violences sexuelles.

Je vais me coucher dans une chambre vide, protégée par la fine moustiquaire qui m'entoure. Cela fait deux ans et onze jours que mon père est décédé. Pendant tout ce temps, pas une seule fois je ne lui ai parlé ou vu dans mes rêves. Ce soir, la lune est si grosse dans le ciel de velours, elle semble suspendue plus bas que d’ordinaire. Le camp est silencieux, et juste au moment où je m'endors, mon père est là, me secouant doucement pour me réveiller. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'es pas mort ? » Je lui demande. « Si, je suis décédé », répond-il. « Allons-nous promener. » Alors que nous marchons sur le sentier boueux sous la pleine lune, mon père me parle. Je lui pose des questions, je lui demande s'il est heureux, et il me répond que oui. Il me dit de tenir un journal de toutes mes pensées chaque jour. « Mais pourquoi, papa ? » Il sort un petit carnet de sa poche, en feuillette les pages et me montre ses notes et les tâches quotidiennes qui y sont griffonnées : « Tu te souviens de ça ? » Je lui réponds : « Oui, je m'en souviens ». Le matin, je suis réveillée par son murmure près de mon oreille, et je découvre qu'il est parti. Je suis si confuse à mon éveil, avec le sentiment d’être entourée d'un épais brouillard, comme celui qui recouvre l'horizon en Ituri. Je pense à la protection que me procure le souvenir de mon père, même après sa mort, et au fait que des milliers de femmes au Congo ne pourront jamais avoir un sentiment similaire.
© Newsha Tavakolian / Magnum Photos
Un hôpital à Nizi, où femmes et enfants sont soignés.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosAu centre de santé de Drodro, pendant qu'elles attendent leur tour pour recevoir les soins dont elles ont besoin, les femmes sont assises sur la chaise que j'ai placée contre le mur. Elles trouvent de petits moyens de s'occuper et de se distraire pendant qu'elles parlent. La fille en jupe bleue et haut noir se gratte le dos de la main. Dans l'obscurité de la salle d'examen au mur bleu, les détails les plus visibles sont les accessoires colorés qui ornent les corps frêles de ces femmes : une jupe verte, un bracelet rose, un foulard rouge, une broche papillon et un collier plongeant avec des perles bleues. Elles ne me regardent pas directement, mais je les vois et je me souviens de tous ces détails individuels, mon appareil photo également.
Lorsque je suis arrivée à Drodro, je craignais que les femmes ne m’évitent, mais aujourd’hui, je suis étonnée qu’elles viennent me voir pour me raconter leur histoire, sachant que je suis photographe et non humanitaire. La plupart des victimes vivent dans la honte et la culpabilité de cette expérience horrible sur laquelle elles n’avaient aucun contrôle. Pourtant, on ne peut pas mettre dans une même case toutes ces femmes et ces filles. Aussi courante soit-elle, l’expérience collective de la violence n’efface pas son impact individuel. Chacune d’elle mérite d’être entendue.


Noella Alifwa et ses collègues de la radio Sofepadi (Solidarité féminine pour la paix et le développent intégral) sont ici non seulement pour écouter ces histoires, mais aussi pour les utiliser afin de sensibiliser le public. Noella, ainsi qu’un groupe d'autres femmes ont travaillé dans une station de radio ici il y a environ 21 ans. Ensemble, elles ont fondé une ONG par le biais de laquelle elles ont commencé à parler de la violence sexuelle. Noella me dit que leur collectif a quatre objectifs majeurs : 1) familiariser les femmes avec leurs droits ; 2) travailler à la création de communautés pacifiques où les femmes peuvent se sentir en sécurité ; 3) plaider pour de meilleurs dirigeants ; et 4) apprendre aux femmes à prendre soin d'elles- mêmes, à la fois immédiatement après avoir été agressées, et dans une perspective à plus long terme. Leur ONG travaille sur plus de 50 cas d'agressions sexuelles par an, tout en continuant à tendre la main et à offrir de l'aide. Elles ne croient pas que le changement puisse se produire du jour au lendemain. Au contraire, elles sont conscientes qu'en raison du contexte culturel qui fait des femmes des objets et de l'absence d'un système juridique fiable, une réforme lente et régulière est la voie à emprunter. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à cette femme qui interrompait avec colère les annonces de MSF sur les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées causées par le viol, les jugeant blasphématoires et erronées. Je ne peux pas la blâmer. Parce que les croyances si ancrées, aussi nuisibles soient-elles, nécessitent du temps et des efforts pour s'effacer.
La dernière fois que je passe devant la grande croix, Jésus est de retour au sommet, il ne saigne plus, mais ses membres coupés ont été rattachés maladroitement. Il n'y a pas de foule rassemblée autour de la croix cette fois-ci.

Sur la route vers le camp de Rho, le seul endroit où les personnes peuvent aller chercher de l'eau.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosDe retour sur le chemin de terre sinueux, des femmes marchent le long du sentier, le corps alourdi par les lourds jerrycans d'eau et les épais fagots de bois qu'elles transportent jusqu'au camp. La plupart d'entre elles sont habillées de pagnes colorés et ornés de la date du 8 mars : la journée internationale des droits des femmes.
En observant leurs efforts et leur énergie, je me demande si un jour viendra où leurs robes du 8 mars ne seront plus les seuls vêtements qu'elles possèdent, un jour où elles pourront être conscientes de ce que représente le 8 mars et s’émanciper.
Ecrit par Newsha Tavakolian et Sara Kazemimanesh
Abonnez-vous à la newsletter MSF
Les derniers photoreportages


Grèce, l’impasse aux portes de l’Europe par Enri Canaj, 2020

Soudan, réfugiés à la frontière par Thomas Dworzak, 2020

Honduras et Mexique, l’espoir au bout de la route par Yael Martínez, 2021

Mossoul, les oiseaux volent à nouveau par Nanna Heitmann, 2021