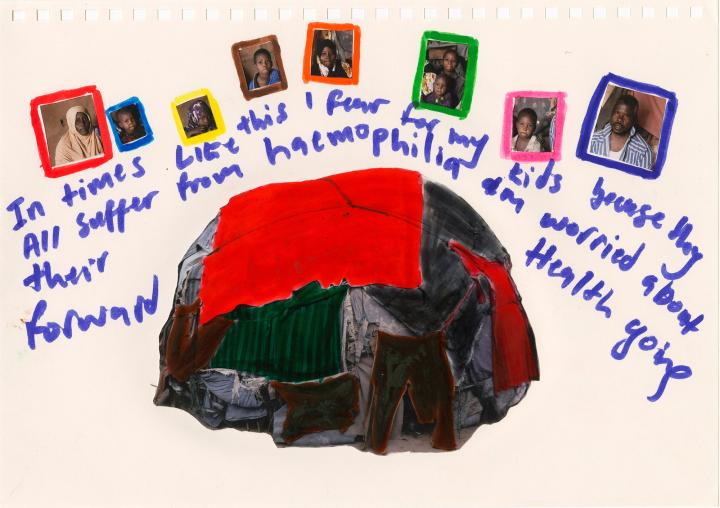Honduras et Mexique, l’espoir au bout de la route
Des milliers de familles ont fui l’insécurité au Honduras, parcourant des milliers de kilomètres à pied, en train ou en bus pour rejoindre désespérément les Etats-Unis. Elles se retrouvent ensuite bloquées au Mexique dans des villes extrêmement dangereuses où elles sont victimes de kidnappings, d’agressions et d’extorsions. Le photographe Yael Martínez, lui-même mexicain originaire de Guerrero, a passé plusieurs semaines avec MSF entre le Mexique et le Honduras pour rencontrer les personnes qui prennent tous les risques pour atteindre le rêve d’une vie meilleure, en sécurité.
Coatzacoalcos, Mexique – En quête du nord

Karen Yoselyn Reyes, 7 ans, voyage depuis 12 jours avec sa mère et sa petite soeur. Parties de Yoro, au Honduras, elles ont marché de Tapachula (Etat du Chiapas) à Coatzacoalcos (Etat de Veracruz). Ce qui inquiète le plus Karen, c'est que sa mère ne pourra pas monter dans le train qui doit les emmener vers le nord parce qu'elle porte sa petite sœur.
© Yael Martínez / Magnum PhotosLe bruit était assourdissant ; pendant un moment, j'ai senti mon cœur battre dans mon oreille gauche, et une vibration m’a traversé des pieds à la tête, lentement, s’élevant du sol jusqu'à envahir complètement mon corps. J'ai vu quelqu'un jeter une pièce de monnaie sur les rails et j'ai observé Yahir, un garçon hondurien de 8 ans, se pencher et ramasser la pièce avec un sourire espiègle, la prendre et me la tendre. J'ai pris ce qui, il y a quelques secondes, n’était qu’une pièce de 50 centimes, une simple pièce de monnaie. Elle était encore chaude du frottement de l'acier. J'ai pensé à ce que peut faire le choc entre deux objets en métal, la pression de la vie, de l'inévitable, de ce que l'on cherche, la pression des grandes choses contre les plus petites. L'image de cette pièce de monnaie jetée était l'image de la quête de nous-mêmes. De la violence que nous incarnons, de la violence que nous vivons, des chemins de vie que nous avons tracés.

Le 23 mars 2021. Un pont près de la voie ferrée à Coatzacoalcos où plus de 700 migrants d'Amérique centrale se sont installés pour passer la nuit
© Yael Martínez / Magnum PhotosAbonnez-vous à la newsletter MSF

La famille Ramirez attend sous un pont le train pour Monterrey.
© Yael Martínez / Magnum PhotosLa nuit tombait déjà et une autre journée sur les rails se terminait. Il faisait noir et les gens se rassemblaient pour faire des feux de camp et se protéger les uns les autres de la nuit. La maison des migrants ici, à Coatzacoalcos, avait été fermée pendant des mois à cause de la pandémie et de la peur du Covid-19. Yahir et son père Wilson ont été bloqués ici pendant des semaines, attendant de pouvoir monter dans un train sans danger. Comme lui, de nombreuses autres familles avec femmes et enfants attendaient la même chose : que le train s'arrête pendant quelques secondes et qu'ils puissent tous monter à bord, sains et saufs. L'attente était longue, et peu à peu, la patience s'épuisait. Ce jour même, une femme était tombée en essayant de monter dans le train en marche. L’image de sa chute avait fait bondir le cœur de chacun, ses cris avaient été entendus malgré les bruits assourdissants du train. Heureusement elle n’était pas tombée sur les rails, elle s'est relevée rapidement et à bout de souffle, elle a continué à courir le long de ces rails vers l’horizon. Peu importe où ils menaient, elle avait pour seule certitude que ces rails étaient son nord à elle.



Le 24 mars 2021. La famille Zambrano attend sous un pont.
© Yael Martínez / Magnum Photos

J'ai dit au revoir à Yahir ainsi qu’aux autres enfants et, avec Yeka, nous sommes retournés à l'hôtel. Juste avant de partir, je me suis approché du feu, pour sentir sa chaleur, pour me sentir proche de ces gens. Sous ce pont et devant les voies ferrées, le temps passe différemment. Le temps s'écoule toujours différemment dans ces espaces où les rêves s'entrechoquent et où les voix se rejoignent, les voix de ceux d'entre nous qui ne sont plus, et de ceux d'entre nous qui ont autrefois quitté notre peuple.


Le lendemain matin, nous sommes partis pour Higueras, une commune qui se trouve plus au nord de Coatzacoalcos, un petit point sur la carte de cette route vers le nord. Nous avons marché le long des voies ferrées et je me suis arrêté pour parler avec deux hommes qui dormaient sous un wagon de train. Ils avaient les pieds tout déchiquetés par la route, ils avaient fait une grande partie du voyage à pied. Soudain l'un d'eux a pointé sa main en direction d’un wagon au lointain. C'était une famille qui faisait un appel vidéo depuis le toit d'un wagon de la bestia [nom que les migrants ont donné au train si dangereux]. Je me suis approché d'eux et j'ai grimpé sur le toit du wagon. Ils arrivaient du Honduras après un voyage de 12 jours. La plus jeune s’appelait Karen, 7 ans. Son regard était différent, comme si, à ses yeux, ces jours avaient été des années. Le vent soufflait et faisait danser ses cheveux, cela lui donnait un air magique comme si elle touchait à peine terre, comme si elle flottait sur ce morceau de fer. Je me suis approché et je l’ai prise en photo. Le wagon a commencé à bouger et nous sommes revenus à cette écrasante réalité. C'était une fausse alerte, juste une manœuvre du train. Karen a dit au médecin qu'elle s'inquiétait pour sa mère et sa sœur, qu'elle voulait s'occuper d'elles, qu'elle avait très peur et que, de savoir que sa mère ne pourrait pas prendre le train et qu'elle seraient séparée d'elle pour toujours, l’empêchait de dormir.



Un père aide sa fille à monter dans le train à Coatzacoalcos, le 25 mars 2021.
© Yael Martínez / Magnum Photos

Sur le chemin du retour, j'ai rencontré Edgar et sa famille. Ils avaient pu prendre le train le matin, mais n’étaient arrivés qu'à Higueras. Ils prenaient un peu de repos dans une petite maison en ruines, à cause d’un incendie dont les marques étaient encore visibles. Il y a quelques jours, ils étaient joyeux et maintenant leurs visages avaient changé. L’incertitude et la peur se lisaient dans leurs yeux. Edgar regardait l'horizon, là où se trouvait le train. La dernière fois qu'il avait essayé de traverser la frontière, ils s’étaient perdus dans le désert, errant sans but. Il m'a avoué que cette fois-là, il avait pleuré comme un enfant parce qu'il pensait que tout était fini, que son horizon serait obscurci à jamais, là, au milieu du désert. Les gardes-frontières les ont trouvés et sauvés, et pour lui, c’était comme une promesse d’une autre vie. Il pensait qu'il n'essaierait plus jamais, mais le voilà qui se remettait en quête d’un autre futur au Texas.

Un paysage sur l'itinéraire du train appelé « la bestia » par les migrants.
© Yael Martínez / Magnum PhotosCe qui rend le voyage éprouvant, c'est de se réduire au silence, de se rendre invisible dans ce paysage, de quitter peu à peu une partie de soi comme on perd une pièce d'un puzzle. Puis, se regarder dans le miroir et ne plus se reconnaitre, se perdre dans cet enchevêtrement de temps, de poussière, de froid.
Aujourd'hui, c'est notre dernier jour le long de la voie de chemin de fer. Nous arrivons avant l'aube, il y a beaucoup de gens qui passent, beaucoup plus qu'à la tombée de la nuit. Je rencontre la famille d'Angel et je commence à discuter avec son père qui me raconte qu’il a vécu il y a des années à Monterey, en Californie. C'est là qu’ils veulent aller. Deverlyn, la plus jeune, est mexicaine, elle est née ici et aujourd'hui c'est son anniversaire. Yeka part en direction d’un magasin et revient avec un mini gâteau au chocolat nommé pingüino, les allumettes font office de bougies et nous chantons tous Las mañanitas, une chanson traditionnelle mexicaine d’anniversaire. Aujourd'hui elle fête ses deux ans, son père la regarde en versant une larme et sourit. Heureux, les enfants mangent le morceau de gâteau et retournent jouer. En retrait, un mur vert s’éclaire et Angel commence à jouer avec son ombre sur le mur. Avec cette image, l’idée me vient que ce qui nous divise est notre propre ombre, nos peurs et nos représentations de ce que nous étions, de ce que nous pouvons être, de ce que nous ne reconnaissons pas, de l'autre. Les heures filent et il est temps de partir. Je dis au revoir à tout le monde et au loin, je vois Angel qui court vers moi. Il me serre très fort dans ses bras et me dit que je vais lui manquer. Un frisson me saisit. Je lui dis d'être fort et de ne pas arrêter de rêver, d’imaginer ce voyage comme un jeu, comme un rêve qui va se terminer. Maintenant, le nord pour moi est vers le sud, vers sa terre, vers notre terre, pour essayer de comprendre pourquoi les personnes partent, et pourquoi nos enfants ne seront plus de là-bas.

Le 25 mars 2021, Angel Alexis Ramirez Mejia, 9 ans, joue sous le pont de Coatzacoalcos. Depuis son départ de Comayagua, au Honduras, sa famille et lui ont voyagé pendant 16 jours, dont 14 effectués à pied.
© Yael Martínez / Magnum PhotosHonduras – Marquées à jamais
Les histoires que j'ai du Honduras me viennent des familles que j'ai rencontrées sur les routes, des familles de Lloro, Comayagua, San Pedro, Zambrano, Santa Barbara. Toutes m'ont dit qu'elles n'avaient rien à perdre en quittant ces terres, c'est pour cela qu'elles partaient, que sur ces terres elles avaient tout perdu.

Les conséquences des ouragans de 2020, dont les inondations, sont encore visibles dans le village de Banderas, le 8 avril 2021.
© Yael Martínez / Magnum PhotosVu du ciel, on dirait une forêt tropicale paradisiaque verdoyante et pleine de couleuvres d'eau. Lorsque je touche la terre, elle me semble familière, comme si je me trouvais quelque part au Chiapas ou sur la petite côte de Guerrero, au Mexique. Tout m'est familier, même l’atmosphère que l'on ressent dans les endroits qui ont été pénétrés par la violence, les murs des barrios (quartier) de Choloma sont presque identiques à ceux du quartier de Las Cruces à Acapulco. Tous deux sont marqués par le temps, par la poussière, par le sang et la sueur des hommes.

San Pedro Sula, region de Cortés, Honduras. Le 9 avril 2021. Le quartier de La Planeta a été dévasté par les ouragans de l'année 2020.
© Yael Martínez / Magnum PhotosTu marches et tu te déplaces et ton inconscient te dit que quelqu'un te regarde, sans pouvoir voir son visage ou dire son nom, ses noms, tels des dieux oubliés, telle la terre qui a été brûlée.

Choloma, Honduras. Une victime de violence sexuelle pose pour un portrait.
© Yael Martínez / Magnum PhotosY.M. a été victime d'abus depuis l'âge de 8 ans de la part de ceux qui étaient de sa propre chair et de son propre sang. Cela a créé un vide profond qu'elle a voulu combler de manière compulsive par des excès, en se perdant elle-même, en se perdant dans la rue. Ce sont ses enfants qui lui ont donné une raison de vivre, de se battre et de quitter progressivement le corps qui a expérimenté toutes ces émotions, ce corps marqué par la famille et qui apprend à pardonner et à chercher de nouveaux horizons. L'image qu'elle a choisie pour se représenter est une photographie d’elle travaillant aux champs. Sur la photographie projetée, on ne le remarque pas, mais elle est enceinte et, sur cette image, elle se sent épanouie, dotée d’une force de vie et de résistance pour affronter tout ce qui se présentera à elle sur cette terre.
N.V. pousse un soupir quand elle repense à son enfance, qu’elle se rappelle comment la barrière pour protéger son espace vital, son corps, préserver son âme, a été brisée. C’est cela de regarder dans les yeux des personnes que vous pensiez vos protecteurs et d'y voir le visage de vos bourreaux. Quand on vit ces expériences, on n'a plus envie de vivre, on est envahi par la culpabilité et on se sent sale. Voilà ce qu'elle nous a dit. Elle a choisi une image de sa fille, son infirmière, et à ce moment-là, son visage était détendu, lumineux, emplissant la pièce de sérénité.
Lorena était très nerveuse, elle n'arrêtait pas de faire des mouvements avec son pied droit sur le sol et sa respiration était saccadée. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a commencé à parler de son histoire, des larmes ont coulé sur son visage et elle s'est tue. En écoutant sa respiration, on pouvait sentir qu’elle tremblait intérieurement. Cecy lui a tendu une serviette, Lorena l’a prise, a essuyé ses larmes et, avec la serviette humide, a enveloppé l'index de sa main gauche. Tout à coup, à ce moment-là, les images des derniers jours ont défilé dans ma tête, de la chaleur intense, de la faim, des paysages détruits, des maisons désolées, des personnes qui se débattent pour trouver un endroit sûr. Toutes ces images projetées dans ma tête contrastaient avec le silence de la nuit, avec le gazouillis des oiseaux.

Tegucigalpa, quartier de Nueva Capital, Honduras, le 15 avril 2021. A.E.A., 34 ans, victime de violence sexuelle, à son domicile
© Yael Martínez / Magnum PhotosPeu à peu, la voix de Lorena s'est calmée, et lorsque l’on s’en est rendu compte, la nuit était là. Elle nous a parlé de son coin à elle, de l'endroit qui la rassurait. La mer était cet endroit où elle regardait simplement le clair de lune et sentait le sable sous ses pieds. Elle a décidé de graver son histoire dans sa peau, de raconter par l'image ce qu'elle avait vécu. Elle a reproduit des symboles de ses expériences de vie. Ce que je garde en mémoire d'elle, c'est l'image d'un pissenlit. Elle nous a parlé de la fragilité de cette fleur et de sa capacité à s'épanouir partout où le vent la porte.
Guerrero, Mexique – Sans issue

Village d’El Pescado, région de Guerrero, Mexique. Le 28 avril 2021. La communauté d'El Pescado n'a pas accès à l'électricité. Seules les maisons équipées de panneaux solaires ont le courant.
© Yael Martínez / Magnum PhotosNous avons voyagé pendant 12 heures pour atteindre la localité d'El Pescado, un long voyage. Nous étions environnés de poussière, la visibilité était parfois presque nulle, et nous avions l’impression d'être immergés dans un autre monde, une autre époque. Pour se déplacer dans les montagnes, il faut connaître le coin, et nous l'avons appris à nos dépens en nous trompant de route. Nous l’avons vite compris quand la route s’arrêtait, une voie sans issue, et cela nous a fait perdre deux heures. Nous avons dû revenir en arrière et demander la direction d’El Pescado à l’un des habitant, qu’il nous indique le nord. La nuit commençait à tomber et nous n'étions toujours pas arrivés au village. Nous pensions arriver vers 17h et il était 20h20, la lumière du jour nous abandonnait. Yeka est devenue nerveuse. Dans la voiture, nous savions tous qu'il est dangereux de conduire de nuit sur ces routes. Dans ces endroits reculés, il n'y a pas d'Etat, la loi est celle décidée par la communauté locale, qui crée son propre service de sécurité. Chacun se défend contre les agressions des narcos et des cartels adverses, et se protège lors des bagarres.
C'est précisément pour ces raisons que nous nous sommes rendus dans cette localité, car il y a quelques mois, un groupe armé a attaqué la communauté, obligeant les habitants à se déplacer. Ici, la lutte se joue pour la possession des terres, des scieries. On ne sème plus de pavot depuis longtemps.
Nous sommes arrivés et avons monté les tentes dans la cour de l'école. Dans le village il n'y a pas d'électricité et cette nuit-là, la lune était magnifique. Elle illuminait les montagnes. Ce soir-là, pour le dîner, nous avons mangé des tortillas faites à la main, avec des haricots, du riz et du poulet. Ce repas nous a été offerts par la communauté. C'était un excellent dîner après un si long trajet.

Village d’El Pescado, région de Guerrero, Mexique. Le 28 avril 2021. Maribel Mujica, 18 ans, avec Gabriel, son fils de 2 ans, chez eux.
© Yael Martínez / Magnum PhotosLe lendemain, la population a commencé à arriver en nombre, les habitants étant privés de soins médicaux depuis des mois. On pouvait lire l'incertitude sur les visages des gens, la crainte était omniprésente. Des militaires, des gardes nationaux et la police d’Etat patrouillaient dans les rues, mais on pouvait sentir que le calme apparent de l'Etat de Guerrero était sur le point de se rompre.

Village d’El Pescado, région de Guerrero, Mexique. Le 28 avril 2021. Dans la localité d'El Pescado, des maisons sont abandonnées en raison de la violence et du crime organisé sévissant dans l'Etat de Guerrero.
© Yael Martínez / Magnum Photos


Javier Hernandez, chef communautaire à El Pescado, dans la région de Guerrero.
© Yael Martínez / Magnum PhotosNous avons attendu de pouvoir discuter avec Javier. Il nous a raconté le moment où les hommes armés ont débarqué. Il nous a parlé des familles qui ont dû tout quitter, des difficultés qui sont les leurs ici et que chacun est abandonné à son sort sans prise en charge sociale. Il nous a dit que les habitants ont pris la décision de rester et de se battre pour ce qu'ils ont, de se battre pour leurs terres et pour leur peuple.
La nuit est tombée et petit à petit, les gens sont repartis chez eux. Certains d'entre eux ont mis une heure et demie pour rentrer à la maison à dos de bête. Les médecins ont apporté des lampes pour éclairer les pièces du centre de santé. Les familles attendaient toujours et les consultations se déroulaient dans la pénombre. L'image qui m'est restée en mémoire est celle d'une mère et de ses filles rentrant chez elles dans l'obscurité. Seules les lumières de leurs téléphones portables éclairaient leur chemin, un chemin qu'elles parcouraient seules dans la nuit. Marcher dans ces circonstances vous pousse dans vos derniers retranchements, c'est un acte de foi.

La famille Arroyo marche dans la nuit pendant deux heures pour rejoindre la maison. Ils ont été obligés de se déplacer en raison du crime organisé.
© Yael Martínez / Magnum PhotosLe lendemain, nous avons quitté El Pescado. Avant de partir nous avons interviewé une famille. Eux étaient partis, ils étaient menacés et la peur se lisait sur leurs visages. La femme a accepté de nous parler. Nous marchions vers la maison d'un de ses proches et en chemin, elle a rencontré une autre femme. Elle est devenue très nerveuse, elle nous a dit que toute la communauté était sous surveillance et qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Elle n’a plus voulu se faire prendre en photo, mais a accepté de nous donner un témoignage. Il était très court et haché, les mots ne lui venaient pas, et les silences, le son de la voix étaient lourds de ses craintes, ses doutes quant à sa vie et celle de sa famille.
Dans l'après-midi nous nous sommes rendus dans le village d'El Durazno. Lorsque qu’on a repéré un groupe de personnes portant des armes automatiques de gros calibre, la tension est montée dans la voiture. Pau est allé à leur rencontre. Ces hommes étaient en colère parce qu'ils croyaient que nous avions apporté du matériel à la communauté d’El Pescado, avec qui ils sont en conflit. Le moment était tendu, mais Pau lui a dit qu'ils pouvaient inspecter nos voitures et constater par eux même ce que nous transportions. Ils nous ont laissé et après quelques minutes, un des représentants de l’autorité du village est arrivé. Il s'est excusé pour l'accueil et nous sommes finalement allés manger. Dans l'après-midi, nous avons pu l'interviewer. Il nous a parlé du contexte local, du besoin de développer l’économie. Il a expliqué pourquoi ils défendent leurs terres et pourquoi les conflits ont lieu. Pau a demandé quelle pouvait être la solution et l'un des hommes armés a pris la parole. Le conflit viendra et, espérons-le, plus tôt que tard. La nuit tombait et le vent soufflait dans les pins. La brume enveloppait la montagne et l'air était lourd.
Nous sommes repartis le lendemain, laissant la sierra pour rejoindre Zihuatanejo. Ces journées furent longues, empreintes d'une atmosphère étrange, d'une sensation de flottement au bord de la rupture. C’était comme dormir d’un sommeil léger qui vous rapproche de la terre, et te fais te sentir vulnérable, et sentir l'eau couler entre tes doigts.

Village d’El Pescado, région de Guerrero, Mexique, le 28 avril 2021. Amairani Mujica, 7 ans, chez elle. En raison du crime organisé, les familles manquent de services médicaux, de sécurité et de possibilité de développement, et beaucoup ont subi des déplacements forcés.
© Yael Martínez / Magnum PhotosIl y a quelques jours, j'ai reçu un message de Yeka, il s'agissait d'une vidéo de femmes en pleurs, implorant l'aide des autorités. Ces femmes, qui avaient reçu des soins médicaux quand nous étions là, se trouvaient maintenant dans le même centre de santé, craignant pour leur vie, pour la vie de leurs enfants. On pouvait entendre les coups de feu au loin, on pouvait sentir comment la peur emplissait les pièces, comment les voix se brisaient. Ces voix étaient celles de différents temps, des voix de filles, d'enfants, de femmes, de mères, de grands-mères, elles se mélangeaient toutes et ne faisaient qu'une, une image uniforme avec un cœur ouvert. Ces terres deviennent solitaires, démembrées, déracinées, infertiles.

Le crime organisé veut s'emparer des forêts pour en exploiter les arbres ce qui est l'une des causes du déplacement forcé des communautés locales.
© Yael Martínez / Magnum PhotosCette odeur de poussière, de terre était la même que celle de Choloma, de Coatzacoalcos, c'est l'odeur des hommes de nos jours, de notre époque.
Tamaulipas, Mexique – Le sang sur l’asphalte
Les villes frontalières m'ont toujours paru violentes, les forces de la nature s'opposant à l'homme, à notre façon de penser et de comprendre la vie, l'homme affrontant l'homme et ce que nous définissons comme la réalité.


L’Etat de Tamaulipas porte toutes ces marques visibles, dans sa géographie, dans son territoire, dans la mentalité de ses habitants. Ici, les rêves ne font pas que rebondir, ils brûlent, ils saignent. Ce territoire s’écoute et on y entend le silence, l'étourdissement, le recueillement des voix qui se lamentent.


Nous sommes le premier jour et nous arrivons, avec Sergio, dans un abri. Nous discutons avec une famille hondurienne qui a fui son pays par peur d'être tuée par des personnes de son propre sang, par sa propre famille. La femme ne peut retenir ses larmes et serre son mari dans ses bras. Elle ne se reconnaît plus. Elle et sa famille ne sont plus les mêmes que celles qui ont quitté le Honduras. Le temps et la réalité les ont changés, ce qu'ils ont vécu les a changés. Cela me donne des frissons de les voir s'enlacer, de les voir se regarder et se retrouver, ils ne sont plus les mêmes qu'au départ du Honduras, ils ne sont plus les mêmes qu'hier, mais cette terrible réalité les a aussi maintenus à flot ensemble et leurs liens sont d’autant plus forts.

Reynosa, région de Tamaulipas, Mexique. Cindy Caceres, 28 ans et Carlos Roberto Tunez, 27 ans. Ils demandent l'asile politique aux Etats-Unis après avoir fui le Honduras pour sauver leur vie.
© Yael Martínez / Magnum PhotosAbonnez-vous à la newsletter MSF
Une autre journée. Aujourd'hui nous avons rencontré une famille multinationale. Un père haïtien, une mère hondurienne, et le plus jeune des enfants, déjà mexicain. Le couple s’est rencontré au Chiapas et la route les a amenés ici, dans le nord du Mexique. Lorsque nous sommes arrivés dans le quartier, une Mexicaine à l’hostilité affichée m'a demandé pourquoi je photographiais. Je lui ai expliqué le travail que nous faisions. Puis nous sommes rentrés dans la maison où vivait cette famille. Une heure plus tard, elle est arrivée complètement transformée, nous insultant et nous menaçant pour nous faire quitter les lieux. La maison était grande, plusieurs familles haïtiennes se la partageait et le quartier était contrôlé par les narco-trafiquants.
Nous sommes partis. Pour moi, le délabrement de cet Etat est devenu de plus en plus clair. Le lendemain, nous sommes arrivés avant l'aube au campement de Reynosa, qui grandit chaque jour. En ce moment, environ 500 personnes y ont été recensées. Tous attendent une opportunité, avec une petite lueur d'espoir. Sur les marches du kiosque se trouvaient des gens qui avaient essayé de traverser le jour précédent, leurs vêtements étaient sales et encore humides, leurs chaussures pleines de boue. Ils semblaient complètement épuisés, physiquement et mentalement. J'ai essayé de leur parler, mais il ne voulaient pas se faire photographier. Mes souvenirs commençaient à se réveiller, la mémoire de mon corps à se charger, mes muscles à se tendre. Pendant ces jours-ci, il m’était impossible de dormir.

Le nouveau campement qui se développe dans le centre de Reynosa abrite environ 500 personnes originaires du Honduras, du Salvador, du Guatemala et du Mexique.
© Yael Martínez / Magnum PhotosNous avons entendu des témoignages déchirants, où l'histoire se répète, où le bourreau semble être toujours le même, où celui qui poignarde l'autre n’est que le reflet de nous-mêmes, de nos rêves ou de nos peurs les plus profondes.

Freddy Alberto Pabon, 49 ans, a quitté le Venezuela à la suite du décès de sa mère et de son frère. Il demande l'asile politique aux Etats-Unis pour lui et sa famille.
© Yael Martínez / Magnum PhotosCette terre n'est plus vivable, elle a été brûlée par nos ambitions, nos sombres désirs.
J'ai quitté Tamaulipas avec pour images la mort, le danger, après avoir vu comment une femme a été renversée par un homme, qui, au lieu de l'aider, a voulu la dégager, la piétiner, et la jeter sur le trottoir comme si elle était un vulgaire objet.

Luisa Coto, 33 ans, a quitté son pays à cause de menaces de mort qu’elle a reçues, le 19 février 2021. Luisa a perdu deux membres de sa famille. Elle vit actuellement dans le campement de Reynosa.
© Yael Martínez / Magnum PhotosJe me suis souvenu qu'on nous avait dit que des femmes et des enfants disparaissaient la nuit dans le campement, sous les yeux de tous, et face à la peur de chacun.
J'étais en vol et l'image de cette femme me restait en tête, son regard perdu, absent, comme si elle était morte. A cette image, la transpiration coulait tout le long de mon corps comme coulait son sang sur l'asphalte.
Ce voyage n'a finalement été qu'un cheminement vers la résilience humaine, une invitation à se battre pour ce que nous appelons la vie. Pour que toutes les voix s'unissent et que le chant de notre existence brûle à jamais.

Le Rio Grande, à Matamoros.
© Yael Martínez / Magnum PhotosLes derniers photoreportages


Grèce, l’impasse aux portes de l’Europe par Enri Canaj, 2020

Soudan, réfugiés à la frontière par Thomas Dworzak, 2020

RD Congo – Ituri, une lueur à travers la fêlure par Newsha Tavakolian, 2021

Mossoul, les oiseaux volent à nouveau par Nanna Heitmann, 2021